Je veux faire appel à la mémoire historique
Oublier est un péché, dit Socorro avec colère, dans un cri d’exclamation, toujours en signe de protestation. Elle a perdu son frère lors de la tragédie de 1968 et sa quête de justice, noyée dans l’alcool, la colère et la douleur, n’a jamais cessé. Elle l’a tourmentée jusqu’à ce que, enfin, à un âge avancé, un indice la conduise à trouver le militaire qui pourrait être responsable de la mort de son frère. Cet événement est le point de départ d’un plan de vengeance absurde que le premier film acclamé de Pierre Saint-Martin, « No Nos Moverán », nous invite à garder en mémoire.

Nominé pour quinze prix Ariel, le film mettant en vedette Luisa Huertas, accompagné de la chanson « La noche total » de Belafonte et avec une saveur nationale qui rappelle les clairs-obscurs de « Güeros » (Ruizpalacios, 2014) et « Temporada de patos » (Eimbcke, 2004), montre que la place Tlatelolco reste un champ de bataille. On s’y bat en écoutant, en se souvenant, en ayant soif d’une justice qui, dans ce pays, est improbable, car elle mène à des impasses ou à de dangereux vices de violence. Ici, tout est chaos, c’est ainsi que l’on vit, dans la ville des rêves de pigeons et des blessures léchées.
Belafonte Sensacional chante : « Calendriers de l’au-delà. Si tu regardes en arrière, tu te souviendras », eh bien, dans « No nos moverán », on perçoit comment, à cause de notre histoire, à cause de ce sang qui macule encore les complexes immobiliers délabrés, nous regardons en arrière, nous nous souvenons, nous perdons un peu de ce qu’est regarder devant soi, vers l’avenir. C’est un film qui, pour une série de raisons, au-delà de son succès et de ses nominations, vaut vraiment la peine d’être vu dans une salle de cinéma, où sa forme nous enveloppe dans les rues qui nous attendent lorsque la salle allume ses lumières et nous invite à sortir, changés, conscients, à la recherche de la cible de Diane la chasseuse (Sculpture représentant la déesse Artémis, ou son équivalent romain Diane, tirant une flèche vers les étoiles. Il s’agit d’une fontaine monumentale située sur une avenue principale à la ville de Mexico.).
C’est pourquoi ce fut un immense plaisir d’avoir l’occasion de discuter avec son réalisateur, Pierre Saint-Martin. Nous avons parlé de l’origine de l’idée du film, de la présence de Belafonte, des processus de déshumanisation au sein du complexe militaire mexicain, et plus encore. Pour une première interview de ma part, ce fut une expérience très agréable, fluide, qui a révélé davantage de raisons de faire connaître ce film. J’écris ces lignes avec le cœur battant de peur, les yeux en alerte, les pieds incertains qui tremblent : un petit tremblement de terre vient de frapper la ville. Putain de ville, comme elle aime faire peur.

L’intrigue du film est basée sur une histoire familiale, réelle et personnelle. Comment s’est passé le processus d’adaptation de cette anecdote familiale en scénario, en collaboration avec Iker Compeán Leroux ?
J’avais l’intention d’écrire un court-métrage pour le 50e anniversaire du 2 octobre 1968, en 2018. J’ai commencé à avoir cette idée d’une femme qui s’occupait d’un militaire, un homme âgé, alors qu’elle était elle-même âgée, et qui ne lui faisait pas payer ses services, mais qui ne le traitait pas bien. En d’autres termes, elle s’occupait de lui et cela avait à voir avec le fait qu’elle voulait être près de lui et, enfin, le voir mourir… Puis j’ai commencé à écrire un scénario, que j’ai montré à Paula Markovitch. Très gentille, elle l’a lu et m’a donné quelques conseils, notamment dans le sens où il fallait que ce soit plus biographique. Je lui ai parlé de ma mère et elle m’a dit : « Eh bien, ça doit être sur ta mère ». Parce que je disais que c’était une histoire sur mon oncle, mais elle a insisté : « Non, c’est sur ta mère » et j’ai répondu : « Bon, d’accord, pourquoi pas ». J’ai commencé à accorder plus d’importance au personnage et moins à l’événement, disons, au motif de la vengeance, et ainsi, petit à petit, cela s’est lié à la situation familiale. J’ai réécrit le scénario, puis je l’ai passé à Iker Compean Leroux (coscénariste) et, même si le scénario comportait des éléments comiques, la première version d’Iker était presque une comédie à part entière.
J’ai commencé à le lire et ça m’a vraiment énervé, jusqu’à ce que je continue à le lire et que ça me fasse rire, parce que ça avait un rapport avec la personnalité de ma mère, ce qu’il avait remarqué. C’est pourquoi nous avons voulu que tout soit un peu plus absurde.
Raconte-moi un peu ce que tu as fait pour que l’histoire soit plus équilibrée…
Nous avons écrit en gardant toujours à l’esprit que notre boussole était ma mère. Autrement dit, ce qu’elle ferait et ce qu’elle ne ferait pas. Qu’est-ce qui l’énerverait ? Qu’est-ce qui lui plairait ? Et comme il y avait beaucoup d’éléments biographiques, j’avais plus ou moins connaissance de tout cela. Ce qui nous a demandé le plus de travail, c’est d’écrire l’intrigue de l’enquête, des choses que nous ne savions pas. Nous avons dû faire des recherches et cela nous a pris du temps.

À partir de la figure de ta mère, du processus avec l’actrice et de la contribution qu’une actrice peut apporter au personnage, comment s’est passée la construction de Socorro avec Luisa Huertas en tant qu’actrice ?
Avec Luisa, cela a été très simple, car lorsque vous travaillez avec une actrice comme Luisa Huertas, vous travaillez avec une collaboratrice, avec une artiste. Elle avait toujours beaucoup de commentaires et de remarques à propos du scénario, des événements qui se déroulaient, et la plupart du temps, ses commentaires étaient très pertinents. Le travail préparatoire que Luisa et moi avons effectué a été très important, car il m’a beaucoup aidé à me motiver. De plus, elle avait été militante dans le mouvement en 68, ce qui m’a également aidé, cela m’a apporté une certaine sérénité par rapport à ce que j’avais mis en place – même si le personnage de Socorro n’est pas une militante – cela m’a permis à avoir du respect.
Et comme je l’ai mentionné, le travail avec elle a été très facile. Quand nous étions sur le plateau, le plus important était de la voir danser et jouer, c’était un vrai plaisir. Il y a très peu à faire quand on a une actrice comme elle et les acteurs que j’avais. Je pense que c’était davantage un travail de direction de casting, que j’ai fait avec Luis Maya, qui est mon directeur de casting, tout comme l’écriture du scénario avec Iker Compeán, ainsi que la conception des personnages et la mise en scène, que j’ai également réalisées en étroite collaboration avec César Gutiérrez, mon directeur photo.

Ce qui m’a beaucoup marqué dans le film, c’est tout le travail sur le son, qui sert non seulement à la construction du personnage, mais aussi à évoquer la mémoire et à situer le film à Tlatelolco, et en ce sens, à projeter que 68 continue de se produire à travers le son. Pourrais-tu nous parler un peu du travail sur le son ?
Je te remercie beaucoup d’avoir remarqué ce détail, car l’un des processus les plus longs du film a été l’écriture du scénario, qui a duré environ un an et demi, et la réécriture environ deux ans et demi. Le deuxième processus le plus long a été la post-production sonore, qui a duré six mois. De toutes les personnes impliquées, les seules à qui j’ai dit que ça allait être difficile, ce sont celles qui s’occupaient du son, car j’avais déjà tout prévu, dès l’écriture du scénario, tout ce qui concernait le son : l’ouïe, les souvenirs… Je pense que c’est le son qui nous aide à nous plonger dans la subjectivité. Oui, l’image aussi, mais je pense que le son est beaucoup plus puissant dans ce sens. En fait, je les ai même mis au travail avant que le premier montage soit prêt pour qu’ils comprennent de quoi il s’agissait. Ils m’ont dit « ça va être minutieux », et ça l’a été, car pour moi, c’est l’une des parties les plus importantes. On dit que c’est 50-50, je suis d’accord, car l’image est une partie importante et l’autre est tout le travail réalisé par Alejandro Díaz, Daniel Rojo et César González, qui a fait le mixage. Ils peuvent le dire parfaitement, nous avons eu une conversation avec Alex Otaola, qui est musicien, mais qui s’est également impliqué dans la conception sonore.

Je pense que ce film arrive à point nommé, car nous continuons d’assister à un processus de militarisation inquiétant, avec des événements récents comme ceux qui se sont déroulés au Foro Alicia. Penses-tu que ce film soit un avertissement, un rappel ?
Eh bien, je ne pense pas que ce soit un appel dans ce sens, comme « méfiez-vous des militaires », c’est plutôt le contraire. Pour moi, le rappel est que les militaires sont des êtres humains, des personnes comme vous et moi, qui vivent un processus qui les déshumanise. C’est plutôt la conversation que nous voulons établir. Il s’agit de comprendre que ces personnes ne font souvent pas ce qu’elles veulent et qu’elles souffrent aussi souvent, et si nous commençons à en parler, nous avons plus de chances de changer ce cercle vicieux, au lieu de nous opposer à elles, car comme tu le dis si bien, il y a de très bonnes raisons de s’opposer à elles et les gens qui les détestent peuvent le comprendre. Je veux faire appel à la mémoire historique, non pas dans un esprit d’antagonisme, mais pour dire comment cela s’est passé et qui est impliqué, et écouter chacune des parties, ce qui ne justifiera rien. Il faut sans aucun doute assumer la responsabilité de ses actes, mais de là à systématiser l’antagonisme contre d’autres personnes, non.
En nous comprenant mieux, nous trouvons de meilleures façons d’arriver à une solution, au lieu de dire qu’il y a des gens mauvais et des gens bons, que les gens mauvais sont ceux qui tirent et les gens bons ceux qui reçoivent les balles. De plus, à quel point pourrions-nous être proches de réaliser ces mêmes actions ? J’ai l’impression que nous sommes devenus plus fascistes, car soit nous avons raison, soit ils ont tort, et s’ils ont tort, alors ils méritent d’être anéantis, détruits. Nous avons aujourd’hui une forte dose de fascisme et de xénophobie, car nous sommes convaincus que si on nous enlève ce qui nous appartient, c’est la pire chose qui puisse nous arriver et cela, je pense, déclenche beaucoup de situations que nous ne voulons pas représenter et que nous représentons sans nous en rendre compte, car nous ne voyons pas à quel point nous ressemblons aux personnes que nous jugions et condamnions.

Pour finir, je voulais te poser une question sur ta collaboration avec Belafonte Sensacional, car je trouve que c’est un groupe très cool, qui contribue également beaucoup à cette nouvelle vague d’artistes mexicains. Comment vois-tu l’évolution de l’art dans la ville et ce type de relations entre le cinéma et la musique, car j’adore ce qu’ont accompli Belafonte et « No nos moverán » ?
Je te remercie beaucoup d’avoir remarqué ça… J’ai rencontré Israel Ramirez (chanteur de BS) parce que je voulais mettre une chanson dans le film, là où Jorge est ivre, rongé par le passé, et ça devait être une chanson rock. Mais trouver une chanson rock, c’est compliqué, on a essayé le groupe Soda Stéreo et d’autres trucs impossibles à obtenir. Alors Alex Otola m’a dit : « Hé, tu as déjà écouté Belafonte Sensacional ? Je pense que ça pourrait t’intéresser et je connais Israel ». J’ai donc écouté « La noche total » (de l’album « Soy piedra »), j’ai kiffé et j’ai dit « putain, c’est trop bon, c’est génial », mais je n’avais pas d’argent pour l’acheter, j’avais tout dépensé. Alex m’a passé son téléphone, j’ai appelé Israel et je lui ai dit : « Écoute, excuse-moi de me permettre, mais je voudrais te demander de m’offrir ta chanson, parce que je ne peux pas te la payer et je ne peux pas te la demander en prêt. J’ai besoin que tu me l’offres pour le film, je te le demande comme une faveur ». Je lui ai raconté l’histoire, il a aimé et a dit « d’accord », et c’est ça Israel / Belafonte. Et maintenant que tu parles de collaboration, nous l’avons prolongée pour la promotion du film. Ils sont en train de préparer leur nouvel album (« Llamas, Llamas, Llamas ») et je lui ai dit : « Pourquoi ne pas faire un mix entre la sortie du film et la sortie de Llamas Llamas ? » Nous avons inclus Socorro et cela a donné un docu-musical, un clip vidéo, un Happening… ». Nous l’avons fait, il a adoré et cela a eu un grand succès.
Nous l’avons fait avec Pimienta et Desde abajo Ccine, pour essayer de faire des crossovers, des mélanges interdisciplinaires, afin de parler de quelque chose qui n’est pas particulièrement l’album ni particulièrement le film, mais plutôt des thèmes que nous avons en commun. Et c’est ce qui se fait de plus en plus, je pense, et je pense que cela a quelque chose à voir avec les réseaux sociaux, car l’idée est née un peu dans le concept des réseaux et je trouve ça très bien, très cool, franchement.
Par Matías Mora Montero / Correcamara
La magnifique forêt de Monte Virgen est sous la protection de Julia. Une nuit, de mystérieuses présences s’y infiltrent : elles abattent des arbres et s’en prennent violemment à ses habitants. Défendre la forêt implique d’affronter ces criminels, dont les actes dépassent le simple délit : ils cherchent à anéantir la communauté et à établir de nouveaux liens commerciaux et de pouvoir. Quiconque s’y oppose sera dépossédé de ses terres ou disparaîtra.
« La Reserva », un film de Pablo Pérez Lombardini, débute par le mystère, flirte avec le thriller et le film social, puis s’achève en tragédie. Julia s’impose comme l’un des personnages les plus marquants du cinéma mexicain de ces derniers temps. Courageuse et déterminée, elle s’obstine à protéger son environnement, contre vents et marées. Elle pourrait tout perdre, sauf sa dignité.
Avec le soutien de FOCINE et EFICINE Producción, et tourné dans la réserve de biosphère El Triunfo à Montecristo de Guerrero, au Chiapas, « La Réserve » a remporté les prix de la meilleure actrice, du meilleur réalisateur et du meilleur film au 23e Festival international du film de Morelia.

« La Reserva » est une fiction, mais elle donne l’impression d’être inspirée d’une histoire vraie. Quelle est l’origine de cette histoire ?
Elle est née d’un reportage que j’ai lu sur le Mexique, l’un des pays où le plus grand nombre de défenseurs de l’environnement perdent la vie chaque année pour la protection de la nature. Je pensais que ce sujet méritait d’être traité au cinéma, et la tragédie me semblait la structure dramatique la plus appropriée. J’ai mené des recherches dans des communautés du Chiapas, où j’ai recueilli des éléments qui ont conféré de l’authenticité à l’histoire. Une anecdote s’est avérée cruciale : un garde forestier m’a raconté qu’un de ses champs avait été envahi par un groupe de personnes démunies, elles-mêmes victimes de dépossession. Ce conflit illustrait parfaitement la complexité du problème. J’ai décidé de construire l’histoire et le scénario à partir de là.
La Reserva aborde la dépossession et la défense du territoire. Mais à l’analyse de l’intrigue, un autre thème puissant se dégage : la difficulté de créer une défense collective. Comment avez-vous travaillé sur cette idée ?
Défendre un territoire est un processus complexe. Sa plus grande difficulté réside peut-être dans notre incapacité à nous organiser. Que ce soit dans de petites ou de grandes communautés, notre seule alternative est de reconstruire le tissu social, de renforcer le sentiment d’appartenance à la communauté et d’affronter collectivement les menaces.
Le problème de nombreux défenseurs de l’environnement est qu’ils s’isolent souvent, tels David face à Goliath, ce qui les rend vulnérables. C’est pourquoi je pense que la solution réside dans la recherche, malgré toutes les difficultés, de moyens de renforcer la communauté et d’apprendre à parvenir à des accords dans la poursuite d’objectifs communs. Bien sûr, c’est une tâche immense, mais nous devons la mener.
Julia incarne un personnage tragique, au sens le plus classique du terme. Comment s’est déroulé le processus de création de ce personnage ?
Je me suis inspirée des défenseurs de l’environnement pour créer Julia. Nombre d’entre eux, à un moment donné de leur combat, sont conscients que continuer pourrait leur coûter la vie, et pourtant ils persévèrent. Ils préfèrent tout risquer plutôt que de tolérer les injustices. Cette conviction les transforme en figures tragiques, à l’instar des héros de la tragédie grecque : des êtres qui affrontent des forces qui les dépassent, mais qui ne renoncent pas à leurs principes.
On dit que la tragédie n’existe plus à l’époque moderne, mais dans notre contexte latino-américain, elle demeure pertinente, notamment dans les luttes pour la défense de l’environnement. Julia incarne cela : elle n’est pas un personnage parfait, elle a des défauts, des contradictions, mais elle ne perd jamais sa dignité et ne cherche jamais à la voler aux autres, même au cœur d’un conflit complexe.
Arthur Miller disait que le héros tragique perd tout, sauf sa dignité. Cette idée a profondément résonné en moi et a été essentielle à la compréhension et à la structuration du récit.
La plupart des acteurs de La Reserva sont des non-professionnels. Comment les avez-vous trouvés ?
Le casting est composée d’acteurs non professionnels. Carolina Guzmán devait m’accompagner lors des recherches de terrain dans la région où je prévoyais de tourner le film. Mais en la rencontrant et en écoutant son histoire, j’ai su qu’elle devait être l’héroïne. Ce fut une rencontre fortuite.
En la voyant à mes côtés, les habitants de la biosphère m’ont ouvert leurs portes et m’ont accordé leur confiance. J’ai interviewé une centaine de personnes et j’en ai sélectionné une trentaine pour le film. Par la suite, nous avons organisé deux ateliers de jeu d’acteur, d’une semaine chacun, avec Tania Olhovich.
Durant ces ateliers, nous avons tissé les liens de confiance nécessaires au tournage. Parallèlement, nous avons réécrit le scénario en intégrant les contributions des participants. La distribution s’est constituée grâce à l’écoute, la confiance et une compréhension claire de nos intentions : réaliser un film authentique, né de la communauté elle-même.
Pourquoi avoir filmé en noir et blanc ?
Le noir et blanc permet de voir les choses d’un œil neuf. Il nous a également permis d’homogénéiser les espaces de tournage, sans avoir à les modifier profondément. La palette de couleurs de ces communautés n’était pas harmonieuse, mais le noir et blanc a rendu les lieux plus intéressants et visuellement cohérents, leur conférant une unité esthétique très agréable.
J’ai également réfléchi à la musique dès le début du projet et j’ai senti qu’en combinant le noir et blanc à la bande-son, le récit atteindrait une dimension plus poétique, s’éloignant du naturalisme. Ce choix esthétique a mis en lumière certains aspects intemporels de l’histoire.
Au départ, certains collaborateurs étaient sceptiques ; ils regrettaient la disparition des couleurs de l’environnement. Cependant, avec le temps, ils ont compris que ce choix était non seulement judicieux, mais aussi le plus approprié pour le film que nous souhaitions réaliser.

La majeure partie du tournage s’est déroulée à Montecristo de Guerrero, au sein de la réserve de biosphère El Triunfo. Comment s’est déroulée l’expérience du tournage là-bas ?
Tout a commencé par une demande d’autorisation auprès des assemblées ejido. Ensuite, l’essentiel a été de revenir plusieurs fois. Cela fait toute la différence dans les communautés, car les gens sont habitués à voir des étrangers arriver, faire de belles promesses et disparaître.
En tenant parole, nous avons instauré la confiance et même tissé des liens d’amitié. Nous avons filmé avec une petite équipe, sans gros camions ni productions fastueuses. À ce moment-là, une solide base de respect et de proximité s’était déjà établie. Presque toute l’équipe principale — le directeur de la photographie, le chef décorateur, la costumière, l’assistant réalisateur et le producteur — avait déjà travaillé sur le projet, ce qui a renforcé nos liens avec la communauté.
Au cinéma, le débat porte souvent sur le documentaire ou la fiction, tout comme en littérature il existe un débat entre le récit non fictionnel et le roman. Dans votre cas, vous abordez un sujet qui aurait pu être traité comme un documentaire, mais vous avez opté pour la fiction. Pourquoi avoir choisi cette perspective narrative ?
Dès le départ, je savais que réaliser un documentaire impliquerait des défis éthiques et de sécurité complexes. Si la fiction présente elle aussi des dilemmes éthiques, elle offre une plus grande liberté pour explorer le sujet en profondeur.
Puisque l’accent était mis sur le parcours intérieur d’une militante écologiste, nous souhaitions éviter les contraintes du documentaire et nous accorder une perspective plus libre et plus poétique. Bien que nous ayons intégré des éléments de réalité, nous l’avons fait au sein d’une structure narrative fictionnelle.
Ce mélange nous a permis de donner forme et sens à des situations qui, dans la réalité, sont chaotiques ou difficiles à représenter. En ce sens, la fiction est devenue un outil pour ordonner la réalité et créer un consensus autour d’un récit qui, bien qu’inspiré de faits réels, recherche une vérité plus émotionnelle que littérale.
Par Carlos Ramón Morales / IMCINE
La Reserva (Mexique, 2025). Réalisation et scénario : Pablo Pérez Lombardini. Production : Liliana Pardo et Pablo Pérez Lombardini. Société de production : Pikila. Image : Moritz Tessendorf. Décors : Selva Tulián. Musique : YOM. Son : Fernando Hurtado. Montage : Florian Seufert. Avec : Carolina Guzmán, Abel Aguilar, Verónica Ángel Pérez, Corina Paola Pérez.
Je me souviens du tournage de Entre Marx et une femme nue, le film de Camilo Luzuriaga, dans les années 90.
Une scène se déroule lors d’une fête au siège du Parti communiste. À un moment donné, Margara María, la protagoniste, jeune, belle et toujours critique, militante de gauche et défenseure de ses idéaux, entre dans une pièce isolée où trône un immense portrait de Lénine. Perdue dans ses doutes et ses pensées, elle est surprise par derrière par Braulio, le secrétaire général du Parti et candidat au Congrès. Il l’embrasse dans le cou. On ne sait pas si elle accepte ou non ; elle ferme simplement les yeux jusqu’à ce qu’elle s’effondre face contre terre, le corps de Braulio sur elle. Elle ne crie pas, ne se défend pas ; seul un léger mouvement de rejet se lit sur son visage tandis que l’on entend les gémissements de Braulio. Il a le pouvoir. Il doit la soumettre, il doit lui faire comprendre qu’elle n’est bonne qu’à être possédée sexuellement. Il la viole en silence. Le reste des militants, y compris l’intellectuel révolutionnaire Gálvez et son compagnon en fauteuil roulant, profitaient de la fête.

À cette époque, beaucoup d’hommes de gauche avaient les cheveux longs, portaient des casquettes à la Che Guevara et d’épaisses lunettes, fumaient des cigares et nous appelaient « compañeritas » (petites camarades). Ils se considéraient comme anti-patriarcaux et même féministes (bien que le terme ne fût pas courant alors). Ils prétendaient être solidaires des femmes ; ils embrassaient et serraient tout le monde dans leurs bras sans distinction. Ils scandaient des slogans en faveur des droits de chacun. Lors des assemblées, ils parlaient avec emphase, et beaucoup de femmes étaient captivées par leurs discours, et ils le savaient. Ils savouraient ce pouvoir. C’est pourquoi, après quelques verres, il était courant de les entendre dire qu’ils avaient « couché avec presque toutes ». Une rumeur, qui circulait dans les couloirs, prétendait qu’après les fêtes, les assemblées, les réunions de parti et les manifestations, ils infligeaient à leurs compagnes des violences physiques et psychologiques, en totale contradiction avec leurs discours sur la construction de l’« homme nouveau ».
Nombre de ces machos de gauche (à quelques exceptions près, comme le veut la règle) sont devenus des personnalités publiques. Ils ont accédé à la célébrité politique et ont même siégé dans divers gouvernements, mais au fond, ils restaient pareil à Braulio dans le film. Ils n’ont jamais admis, et n’admettront jamais, leur sexisme et leur misogynie. Quand on osait le leur dire, ils se défendaient avec véhémence, sans se rendre compte que cette véhémence était directement proportionnelle à leur machisme et à leur violence. Ils traitaient de « féministes moustachues » les femmes qui osaient les confronter. Ils faisaient partie intégrante du système même qu’ils clamaient haut et fort devoir changer. Pourtant, ils défendaient leur propre histoire patriarcale. Derrière leurs masques d’« hommes nouveaux », ils cautionnaient secrètement le système, alors même qu’ils étaient déjà vieux et de plus en plus violents.
Mais le plus triste dans tout cela, c’était, et ce sera toujours, le silence assourdissant des femmes témoins de la violence insidieuse de ces machos. Elles ont pris leur parti, et même si elles ont vu les larmes silencieuses de nombreuses Margarita María, elles ont détourné le regard et continué leur chemin, tout comme Ríspido, le poète graffeur, dans le film, lorsqu’il voit ce que Braulio voit.
Entre Marx et une femme nue était-il un film prémonitoire de ce qui se passe aujourd’hui, ou ne faisait-il que dépeindre l’esprit d’une époque ? N’était-il donc pas question d’une personne, d’un événement ou d’une institution, comme l’affirmait son réalisateur à l’époque ? J’en doute maintenant. Ces hommes de gauche, personnages du film et de la réalité, prônaient la pensée progressiste. Et, en principe, ils auraient dû être de véritables féministes, des féministes de chair et d’os ; mais ils ne l’étaient pas. Leurs homologues de droite, tout aussi sexistes et misogynes, défendaient les valeurs traditionnelles que les hommes de gauche prétendaient combattre, mais en privé, ils étaient exactement les mêmes. C’est pourquoi ils ont une dette immense envers l’histoire en matière d’égalité des sexes.
Dans la vie, comme dans le film, la désillusion fut rapide, et nombre d’entre nous ont quitté le parti, devenu bientôt une institution délabrée, obsolète et anachronique. Ces hommes restent gravés dans nos mémoires, et tandis que j’écris ces lignes, mes mains tremblent et transpirent à nouveau, mais je suis convaincue qu’il faut le dire maintenant, après tant d’années, même si cela doit entraîner une excommunication définitive.
« Entre Marx et une femme nue » était l’autoportrait d’une génération qui croyait en un autre monde possible, alors que tout était interdit, même l’amour, comme l’annonçait sa bande-annonce. Mais la réalité dépasse toute fiction, et tous les Braulio d’aujourd’hui doivent être dénoncés. Car la violence faite aux femmes est bien la responsabilité de tous, de droite comme de gauche, qu’il s’agisse de Bertolucci, Allen, Polanski, Trump, et ainsi de suite.
Par Mariana Andrade, Productrice de cinéma / ochoymedio
Dans un entretien avec Diario Mendoza, les réalisatrices de « Antes del cuerpo » réfléchissent sur le croisement entre drame social et horreur, et sur la force féminine qui anime leur film.
Antes del cuerpo est un film qui allie beauté visuelle, sensibilité et un récit aussi intime que troublant. Réalisé par Lucía Bracelis et Carina Piazza, le film raconte l’histoire d’Ana (Mónica Antonópulos), une infirmière qui subvient aux besoins de sa famille au prix d’énormes sacrifices, tout en prenant soin d’un écrivain malade (Patricio Contreras). Sa fille, Elena, souffre d’une maladie mystérieuse qui menace ce fragile équilibre. Dans sa lutte pour survivre, Ana est confrontée à un choix impossible qui la mènera aux limites de l’humain.
Un processus créatif partagé
Bracelis et Piazza nous ont raconté que l’écriture du scénario avait duré environ un an. « Nous sommes parties d’un synopsis et avons sans cesse enrichie le récit, en ajoutant des personnages et des thèmes. Nous avons échangé les versions, et à chaque fois, l’histoire gagnait en complexité, devenait plus vivant », se souviennent-elles.
Dès le départ, toutes les deux étaient décidées à narrer un drame social sous un angle différent. « L’horreur nous permettait d’aborder les souffrances de notre société sans tomber dans un réalisme simpliste. Nous voulions créer une métaphore de la peur de l’autre, de ceux qui vivent en marge, des pauvres. Nous avions le sentiment que seul le fantastique pouvait nous permettre d’atteindre une forme de justice symbolique », ont-elles expliqué.
Dans Antes del cuerpo, la terreur ne vient pas de créatures extérieures, mais du regard social qui stigmatise la différence. « Nous souhaitions remettre en question l’idée que les pauvres doivent toujours être bons et dociles. Dans notre récit, le monstrueux peut aussi être une réponse à l’oppression, une façon de survivre », expliquent-ils.
L’art comme refuge
L’art est omniprésent dans ce film, des jeunes improvisant des slams dans les quartiers périphériques à un vieil homme malade qui, dans l’attente de la mort, écrit des histoires pour une petite fille. À ce propos, l’un des aspects les plus émouvants de « Antes del cuerpo » réside dans la présence de dessins qui imprègnent le récit, créés par la grande artiste Marta Vicente, originaire de la ville de Mendoza. « Nous voulions que l’univers visuel de la petite fille soit empreint d’une sensibilité féminine. Nous recherchions une artiste capable de comprendre de l’intérieur ce monde enfantin, à la fois fragile et puissant », confient les réalisatrices.

Vicente, peintre et graphiste de renom, a créé une série d’illustrations qui s’intègrent à l’intrigue. « Elle nous a demandé de lui raconter l’histoire, pas de lui donner un scénario. À partir de là, elle a inventé son propre univers. C’était magique », se souviennent-elles. Dans le film, l’art est présenté comme un espace où les personnes souffrantes et invisibles peuvent s’exprimer, se libérer ou simplement laisser libre cours à leurs émotions.
Le tournage de Antes del cuerpo a eu lieu en 2023, alors que l’INCAA (Institut national du cinéma et des arts audiovisuels) était encore un organisme fédéral et que des appels à projets étaient ouverts. Cependant, durant la post-production, le changement de gouvernement a profondément modifié les politiques culturelles et compliqué l’accès aux financements. Ce contexte, expliquent les réalisatrices, « a engendré de nombreux problèmes qui auraient pu être gérés avec plus de temps et d’attention ».
À ces difficultés financières s’ajoutait le défi de tourner en province et d’être des femmes à la tête du projet. « Il est difficile de faire des films en Argentine ; c’est encore plus difficile à Mendoza et en tant que femme », reconnaissent-elles. Pour surmonter cet obstacle, elles ont décidé de constituer une équipe majoritairement féminine, avec des directrices artistiques, des directrices de la photographie et des assistantes réalisatrices. Ce choix, expliquent-elles, leur a permis de travailler dans un environnement bienveillant, respectueux et stimulant.
Antes del cuerpo est une œuvre singulière dans le paysage cinématographique de Mendoza et qui mêle horreur et fantastique au quotidien, dans un style qui n’est pas sans rappeler l’œuvre littéraire de l’argentine Mariana Enriquez. Les réalisatrices citent également l’écrivaine argentine Samanta Schweblin, l’univers sonore du film A Girl Walks Home Alone at Night (2014) d’Ana Lily Amirpour, et les films d’Andrea Arnold comme sources d’inspiration – autant de figures féminines inspirantes.
Ce film marque une rupture avec le cinéma traditionnel réalisé en province et s’inscrit dans un courant du cinéma argentin qui intègre le fantastique comme mode d’appréhension du réel – un mouvement sans cesse salué.
Par Agustina Lavizzari / Diario Mendoza
Dans Cuando las nubes esconden la sombra (Quand les nuages cachent l’ombre), le dernier film du réalisateur José Luis Torres Leiva, María se rend à Puerto Williams, à la pointe sud du Chili, pour tourner un film. Mais lorsqu’une violente tempête empêche l’équipe d’arriver, elle se retrouve bloquée et seule. Alors qu’elle cherche à soulager une soudaine et intense douleur au dos, María commence à découvrir le rythme de vie de la ville la plus australe du monde – et avec lui, un chapitre irrésolu de son passé.

Méditatif et atmosphérique, le film se déploie comme un journal intime de solitude et de révélations, capturant la beauté fragile du lieu, des souvenirs et du passage du temps. Avec María Alché – réalisatrice argentine et actrice principale de La niña santa de Lucrecia Martel – dans une performance d’une luminosité discrète, Quand les nuages cachent l’ombre explore les géographies mystérieuses de la province antarctique chilienne sous prétexte de suivre la mise en scène d’un tournage, pour finalement révéler une tendresse et une camaraderie profondes dans des gestes anodins, presque imperceptibles.
Quelques jours avant la première du film, j’ai discuté avec Torres Leiva de cinéma, de la recherche d’une communauté dans des espaces géographiques ambigus et de la reconnaissance de la non-linéarité du deuil à travers le partage de la solitude.
Comment est né ce procédé narratif qui retarde le début du film dans le film, pour laisser place à d’autres façons de voir et d’être ? Il fait écho à votre précédent film, El viento sabe que vuelvo a casa.
Oui, il existe un lien fort avec El viento sabe que vuelvo a casa. Ce dispositif fictionnel, cette manière de travailler sur le film, a été une incitation à lancer ce projet et, finalement, à construire le film (Cuando las nubes esconden la sombra) dans ce nouveau lieu, avec ses habitants, capturant ainsi ce qui s’est passé spontanément entre l’actrice et les personnes avec lesquelles elle partageait ce moment. Cela est également né de ma rencontre avec María Alché, qui a été très importante pour moi, car j’avais toujours pensé à elle pour le rôle.
María Alché a aussi un lien avec Le Vent sait que je reviens, n’est-ce pas ? Elle était membre du jury dans l’un des festivals où le film a été projeté ?
Exactement ! María et moi nous sommes revus plus tard dans d’autres festivals, où je lui ai présenté l’idée et proposé de tourner le film dans ce lieu particulier, une sorte de fin du monde/commencement du monde. Et là, un peu, ce dispositif de son rôle d’actrice, de personnage qui, au sein de l’histoire, va réaliser un film (montrant toujours cet artifice cinématographique) et habiter l’attente de quelque chose qui ne viendra jamais, a également émergé.
Un peu comme dans « Le Vent sait que je reviens à la maison », où Ignacio Agüero se rend sur les lieux de tournage dans le but de trouver des acteurs et une histoire, qui s’estompe progressivement au fil du film, ne laissant finalement que les rencontres qu’il fait avec les gens. Cette manière de faire coïncider et de montrer l’artifice a nourri l’intrigue de ce film. Ici, nous avons cherché à créer un voyage introspectif pour le personnage interprété par María, ce qui nous a permis d’inclure tous les événements survenus pendant le tournage, tant pour María que pour l’équipe. C’était aussi une petite équipe, semblable à celle qui a travaillé sur « Le Vent sait que je reviens à la maison », ce qui a toujours donné un sentiment de travail collectif. Et bien qu’il y ait eu un scénario, le film a été repensé jour après jour en fonction des événements. Certaines choses ont été écrites, à partir des recherches que nous avions effectuées, et d’autres se sont déroulées sur le champ.

À l’instar de ce que l’on perçoit dans vos autres longs métrages, votre film, qui mêle les genres de façon très organique, est une docu-fiction. C’est comme si María était un personnage portant son nom, mais pas elle-même, et cette dualité imprègne la structure du film.
Pour moi, le film que María va réaliser est précisément le film qui se fait et qui se découvre au sein de cette intrigue. Le film met en lumière des moments clés de cette transition, liés à quelque chose d’un peu intangible : ce qui arrive à María face au deuil, les moyens qu’elle trouve pour y faire face, et sa rencontre avec elle-même, le paysage et les personnes qu’elle croise. Et comment le thème de la mort apparaît progressivement tout au long du film. Je pense que c’était là, en substance, le processus de création du film. C’est pourquoi il était essentiel de saisir ces moments car, bien que les conversations aient été préparées dès le départ, les personnes ayant travaillé sur le film ont joué leur propre rôle. Et cela a permis l’émergence de nouvelles nuances que María et toute l’équipe découvraient à l’époque. C’est sans aucun doute là que réside la magie du cinéma, qui touche au thème lui-même.
Une scène en particulier me revient en mémoire : celle où María va acheter une bouillotte dans un magasin. Dans le scénario, cette scène semble surtout indiquer l’action, sans dialogue. Nous avons acheté plusieurs accessoires pour le tournage dans ce magasin, et comme la vendeuse a une forte personnalité, nous avons décidé de tourner la scène avec elle. Tous les dialogues sont improvisés. Nous n’avons fait qu’une seule prise. Et c’est ainsi, sans l’avoir prévu, que le thème de la mort est apparu, lorsque María évoque les fleurs qui ornent l’entrée (organisées pour la veillée funèbre d’un habitant de Puerto Williams décédé). Il est étonnant de voir comment une scène improvisée marque le début du lien qui unit le film de María et le deuil.
C’était donc agréable de ressentir à nouveau ce que nous avions éprouvé avec le vent : sentir que le film était vivant.
J’ai remarqué la scène dans le magasin car je trouve formidable qu’elle prenne un nouveau sens à travers le film lui-même et qu’elle trouve un écho plus tard lorsqu’on dit à María qu’il n’y a pas de remède miracle au deuil, puis lorsqu’un guérisseur lui explique qu’il n’existe pas de processus linéaire pour le surmonter. Dans le lien intime que María tisse avec la communauté de Puerto Williams, il est révélateur que son deuil, parfois sans être explicitement reconnu, lui procure un sentiment de solidarité. J’aimerais que vous développiez un peu plus la manière dont l’histoire s’est adaptée au tournage, en évoquant ces petits deuils déjà profondément ancrés dans la communauté.
Après avoir mené nos recherches pour trouver des personnes convenables pour le film, nous avons organisé une séance de pré-casting avec un habitant de Puerto Williams, qui connaissait bien la communauté et les profils que nous recherchions. Pour les auditions, ils ont enregistré des vidéos que nous avons visionnées avant notre départ, et j’ai été frappée de constater combien de personnes parlaient de deuil et de mort sans y penser vraiment ni connaître grand-chose de l’histoire.
Ce qui m’a le plus surprise, c’est le témoignage de Paulina, qui apparaît à la fin, dans la scène de la voiture. Elle y raconte la mort de sa mère et le changement qu’elle a recherché après ce deuil, ce qui l’a amenée à quitter Santiago pour Puerto Williams (comme elle le confie à María dans cette scène). Et puis, avant le tournage, lors de nos entretiens avec chacun d’eux, le sujet est revenu naturellement. Sans nous y attendre, nous allions tourner dans une communauté en proie à un profond deuil, dans un lieu marqué par un sentiment d’isolement. Comme si nous nous trouvions au bout du monde, dans un endroit où l’inconnu demeure.
Paulina avait perdu sa mère dix ans auparavant, mais en parler, c’était comme revivre ce drame. Avec le temps, on peut raconter l’histoire différemment et voir comment notre perception de son absence évolue. Et ce qui me paraît si mystérieux recèle une grande profondeur dans les détails, dans la manière dont cela se passe. C’est pourquoi cette scène est présentée à travers le geste de María lorsqu’après avoir accompagné Paulina à l’hôpital, elle lui dit qu’elle l’attendra pour la ramener chez elle. Et oui, c’est une personne qu’elle a rencontrée à ce moment-là et qu’elle ne reverra peut-être jamais, mais elles ont partagé leur solitude, ne serait-ce qu’un instant, à travers le deuil.
Pour moi, puisque ce film est né du deuil de ma mère et de Rosario Bléfari (à qui le film est dédié), puis de celui de mon père, il m’a rendue plus consciente du présent, de l’ici et maintenant. Et je pense que le film évoque cette idée à la fin, avec sa fin ouverte, car c’est à ce moment-là que María commence à comprendre comment vivre avec le deuil. C’est un début. La somme de toutes ces rencontres, de tous ces liens qu’elle a tissés jusqu’ici, donne un sens à la fin, une forme de réconfort.
Pour moi, réaliser ce film et en parler maintenant a aussi été un apprentissage pour apprendre à vivre avec ce deuil. J’ai eu la chance de pouvoir en faire quelque chose, mais surtout, de mieux comprendre grâce aux réactions.
Et d’en redéfinir beaucoup d’autres.
Exactement.

Il y a un instant, en parlant de Puerto Williams, vous évoquiez la double signification de la fin du monde et la transition qui redéfinit ces géographies, passant de la carte à des plans plus sensoriels. Comme le dit María au scientifique rencontré au cœur de la forêt : « Vous consacrez votre vie à l’étude de ces petites choses dans un espace immense.» En tant que monteuse, après avoir été présente dans cet espace en tant que réalisatrice, comment avez-vous abordé le travail de révision de ces « petits » détails dans l’articulation du film ?
De nombreuses conversations avec María et les autres personnes étaient très longues, durant une ou parfois deux heures, car elles avaient un début et une fin qui, bien sûr, ne seraient pas conservés dans la version finale du film (mais qui étaient importants pour ceux qui n’avaient aucune expérience d’acteur, afin que ce que nous filmions ait du sens pour eux). Ainsi, lorsque nous sommes arrivés au premier montage et que nous avons revu ces séquences de plusieurs heures, certains éléments sont apparus qui donnaient beaucoup de sens au film (comme la scène avec le scientifique, que vous avez mentionnée). Il lui a parlé pendant de longues minutes d’insectes et de ses recherches, mais ce qui a le plus retenu mon attention, c’est ce qui restait à voir.
Et c’était le cas pour toutes les scènes. Revoir ces images était une autre façon d’aborder le film : cela m’a fait prendre conscience de ce que j’ignorais, de ce qui manquait au parcours de María. Et cela rejoint ce que vous dites à propos du regard rétrospectif.
Il y avait quelque chose d’extraordinaire chez María dans toutes ces scènes : cette capacité à écouter et à vivre pleinement le moment présent, donnant lieu à des conversations d’une grande fluidité. Je pense qu’elle ne se contente pas d’interpréter le personnage de « María » tel qu’il est écrit dans le scénario, mais qu’elle y intègre tout ce qu’elle vivait. Il y a un mélange entre le personnage et la réalité, la façon dont elle découvre les histoires à travers les conversations.
Le film a été coproduit par la Corée du Sud, grâce au financement du Festival du film de Jeonju, où il a été présenté en avant-première mondiale (et où vous aviez déjà projeté certains de vos films, comme Verano). Comment cette collaboration déjà établie a-t-elle influencé la dynamique du projet et vos projets les plus récents, comme celui-ci ?
Jeonju est un festival qui a déjà présenté plusieurs de mes films dans différentes sections et qui a la particularité de promouvoir régulièrement le cinéma indépendant. Le festival s’intéresse de près au parcours de certains cinéastes. De plus, il dispose d’un fonds important qui a évolué et qui est devenu un fonds de production destiné à aider les films indépendants à plus petite échelle à voir le jour. Nous avons eu la chance d’obtenir ce financement et d’avoir le festival comme coproducteur, avec une totale liberté pour développer notre histoire et la tourner au Chili.
Au-delà de ce projet, j’apprécie énormément ce festival, et il n’est pas surprenant qu’il ait été si enrichissant pour le cinéma indépendant latino-américain ces dernières années. Matías Piñeiro, par exemple, y a présenté plusieurs de ses films et a réalisé un court métrage, Rosalinda, grâce à leur financement. Il est donc précieux que, outre sa plateforme de projection, le festival s’implique également dans le financement et la production. Surtout, il offre un public cinéphile qui accueille toujours les projets avec un grand enthousiasme. À chaque fois que j’ai pu y assister, les salles étaient pleines à craquer, et je crois que les discussions après les projections étaient les plus longues auxquelles je n’aie jamais participé.
L’enthousiasme est toujours palpable, de la part d’un public qui n’est pas exclusivement composé de cinéphiles, mais d’un public plus large qui se sent concerné par les histoires et par ce besoin de connexion authentique.
Par Natalia Hernández Moreno / Cinematropical / Traduit par Kinolatino
Le documentaire Bajo las banderas, el sol (2025), est le premier long métrage du cinéaste et chercheur paraguayen Juanjo Pereira. La plus longue dictature militaire du continent a eu lieu au Paraguay, dirigée par le général Alfredo Stroessner, qui a conservé le pouvoir pendant 35 ans.
Grâce à un montage précis et percutant, la compilation d’archives trouvées dans différents pays permet non seulement de comprendre, mais aussi de ressentir la douleur causée par la dureté de l’oppression du Parti Colorado, qui a accueilli l’« ange de la mort » d’Auschwitz, le nazi Josef Mengele (médecin personnel du dictateur), tandis que les tortures et les disparitions forcées faisaient des victimes parmi la population opposée à Stroessner. Nous avons discuté avec le réalisateur de son film, du concept d’archives dans un contexte de désintérêt pour leur préservation, et des moyens de créer un documentaire politique qui transmette avec acuité la douleur passée sous silence.
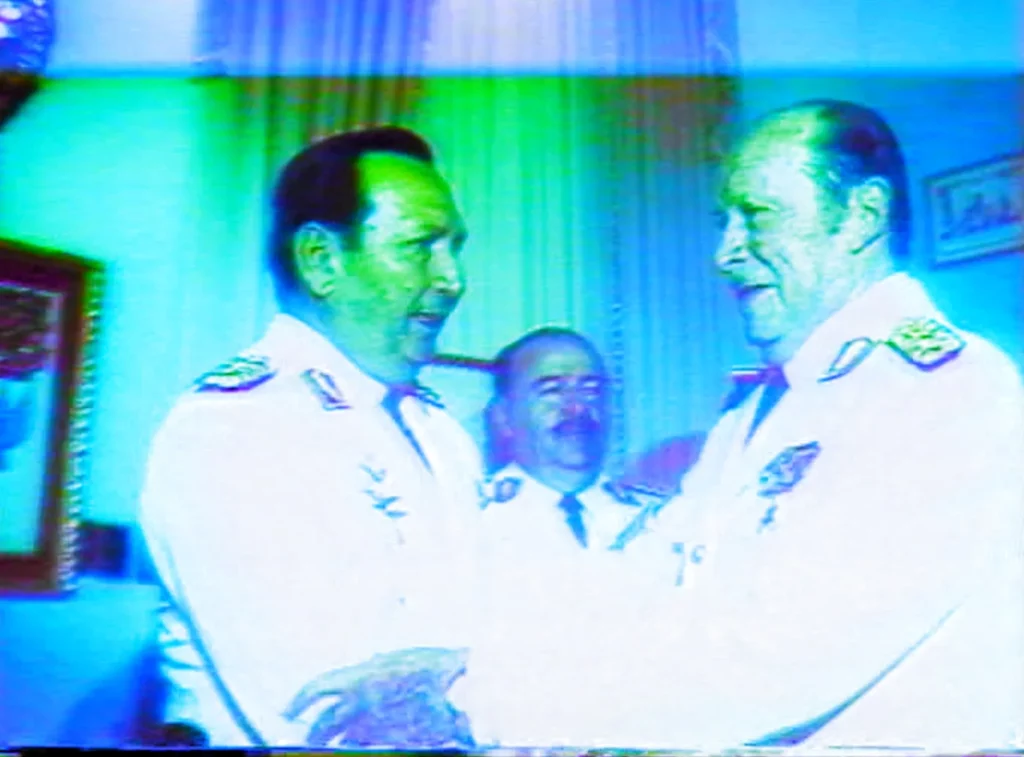
Mariale Bernedo : Juanjo, nous voyons qu’en plus d’être cinéaste, vous faites des recherches dans les archives cinématographiques. Avez-vous toujours été intéressé par les archives liées à la dictature de Stroessner ? Aviez-vous déjà pensé à en faire un film ?
Juanjo Pereira : En fait, je n’y ai pas pensé comme à un film. Quand j’étais petit, je collectionnais des choses et j’aimais beaucoup avoir des fiches. J’aime beaucoup les données, les statistiques, et je suis très curieux dans ce domaine, donc ça a commencé un peu comme ça. Ça faisait partie du jeu. En fait, le projet a démarré en 2018 et s’est transformé en film en 2021. Je me suis dit : « Bon, j’ai toutes ces données et je veux en faire quelque chose », mais j’avais aussi un peu peur d’un projet aussi ambitieux et de porter un fardeau aussi lourd, qui n’est pas l’histoire de mes parents, mais celle d’un pays.
Comment sont gérées les archives au Paraguay ? Sachant que le parti au pouvoir cherche à occulter l’histoire de la dictature.
Les archives au Paraguay sont complexes, car nous avons évoqué le fait que le mot « archive » est également associé à un espace de conservation. Autrement dit, si vous vous rendez aux archives nationales d’un pays, vous vous attendez à ce que tous les documents soient catalogués, à ce qu’il y ait la fiche, le procès-verbal, tout. Parler d’archives au Paraguay et d’archives audiovisuelles est un peu erroné, car cela n’existe pas. Il existe des espaces ou des personnes qui possèdent des choses, mais ils n’en sont pas les propriétaires, ils en sont les gardiens. Ils font ce qu’ils peuvent avec ce qu’ils ont. Ces gardiens, qui ont mené des recherches bien avant moi, m’ont fourni du matériel dont personne ne sait qui l’a filmé, où il se trouve, etc. Certaines choses ont été localisées, il y a des héritiers, mais ce sont des documents très anciens. Le plus intéressant et le plus fou, c’est qu’il y a 40 ans, il y avait vraiment très peu de choses. Au total, ce qu’il y a au Paraguay, c’est environ 3 à 4 heures sur près de 40 ans. Je te parle de choses officielles. Certaines personnes ont chez elles des films familiaux en 16 mm, mais pas les institutions. C’est complexe de voir les choses ainsi. Dans ce sens, je ne sais pas comment le parti au pouvoir va réagir face à ce vide presque illégal. Beaucoup de choses ont également été trouvées dans les poubelles. Il y a des choses que j’ai trouvées et d’autres que le gardien a trouvées. Certaines n’ont pas été utilisées dans le film. Par exemple, le gardien – je dis « gardien » pour ne pas citer de noms – a trouvé dans la décharge municipale une cassette complète d’une chaîne de télévision, qui avait apparemment jeté ses archives, sur la visite du pape au Paraguay. Et il y a évidemment des familles qui l’ont filmée, mais les archives officielles étaient à la poubelle. Je ne sais pas comment, mais il l’a trouvée.
Sait-on quel genre de critère ils ont utilisé pour le jeter ?
Il n’y a pas de critère. D’après ce que je sais d’autres gardiens plus petits, des gens qui ont été formés à la télévision, la décision était aussi simple que « nous avons une pièce de 4m×4m, elle est remplie de boîtes de conserve, il faut les jeter parce qu’il n’y a plus de place ». Et c’était tout, il n’y avait aucun intérêt à les conserver, aucune action systématique, juste un désintérêt total. Dans ce tourbillon d’incohérences et de décisions arbitraires, on ne peut pas parler d’« archives ». Ce sont de petits fragments de choses qui ont été trouvées.
Il est intéressant de repenser le concept d’archive. Cela me rappelle ce que disait Tatiana Fuentes, la réalisatrice de La memoria de las mariposas. En voyant son documentaire, plusieurs personnes ont dit : « Tant d’archives sur le génocide du caoutchouc ! », mais elle a confirmé qu’en réalité, il n’y en a pas tant que ça, mais qu’elles sont rassemblées dans un film, comme c’est le cas dans Bajo las banderas, el sol. Pour ce documentaire, comment avez-vous géré les ressources économiques et le matériel trouvé, notamment au niveau du montage, pour en faire un film ?
Nous avions 100 heures de matériel, entre ce que nous trouvions, ce que nous avions en mauvaise qualité, ce que nous avions comme aperçu des plus grandes entreprises, auxquelles vous écrivez pour leur dire « je veux cet archive », et elles vous répondent « bien sûr, voilà », mais avec une marque horrible, en résolution 480 pixels. Et vous avez le brut, vous avez la matière première. Vous avez donc des impossibilités de travail et une infinité de possibilités de films. Comme vous avez tellement de matériel, vous pouvez faire ce que vous voulez.
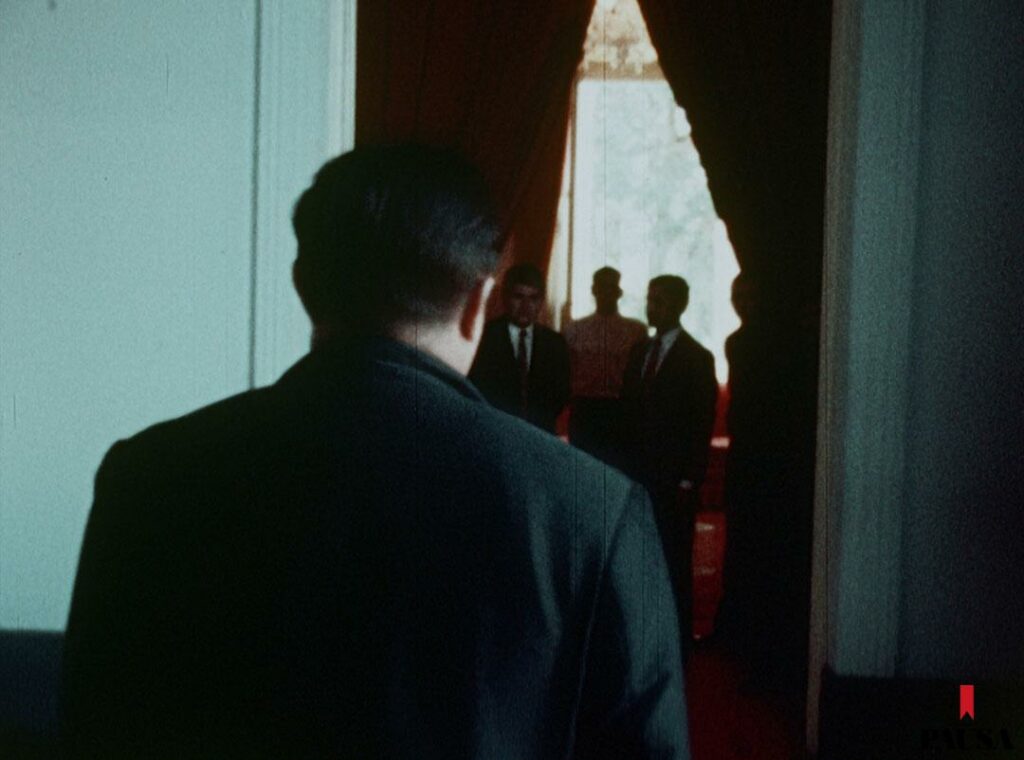
Bien sûr, dès le départ, il y a beaucoup de chemins que vous pouvez emprunter.
Beaucoup de chemins ! Ils sont infinis quand vous avez 100 heures de matériel ou plus, sur différents thèmes, qui ne sont pas des scènes que vous avez filmées. C’était un océan d’images, d’informations, de folies, que nous avons dû cataloguer pendant des années et des années, jusqu’à ce que nous trouvions la solution et que nous disions « bon, ce film sera chronologique ». D’une certaine manière, le film a toujours été à la fois dans les trois étapes : développement, production et post-production. Je le dis toujours et je pense que c’est important. Nous avons essayé d’écrire des scénarios, mais en vain. Le film s’est écrit au montage. Nous avons fait un plan, une structure, mais à partir de là… comment écrire « coupez » ? Il faut le voir. On peut dire : « Bon, j’ai la scène où Stroessner voyage à travers le monde », qui était une scène que nous avons toujours appelée ainsi et qui est dans le film. On peut la nommer, mais on ne peut pas l’écrire : il faut la monter. C’est impossible à écrire. Et une autre chose que j’ai trouvée très intéressante, c’est que l’infinité d’archives a eu une coupure. À un moment donné, nous avons estimé le coût d’une coupure et il en est ressorti, je ne sais pas, 500.000 dollars rien que pour l’achat de l’archive. Nous avons dit : « Ah, bon… ça ne va pas » (rires). Cela a également influencé la décision de chaque coupure. C’était intéressant de passer par ce processus qui consistait à réfléchir à la valeur des choses, à la valeur de mon loyer et à la valeur du film. Je me suis demandé : « Qu’est-ce que je fais ? Est-ce que je travaille pour payer ces gens [ceux qui font payer les archives] ou pour vivre ? Comment se fait-il que le loyer de mon appartement coûte dix secondes d’une archive d’un pays européen ? ». Il y avait beaucoup de questions qui nous mettaient tout le temps en échec, et elles font partie du film. Nous ne le disons pas littéralement, parce que je n’aime pas dire ce genre d’évidences. Mais le film comporte des choix esthétiques et narratifs justes, concrets. Je vais droit au but.
Oui, on le sent direct.
J’aimais que le film soit comme un coup après coup pour le spectateur. Je pense que la production s’est accompagnée de ce choix. John Berger disait que l’image a un double sens, et qu’elle est un déclencheur. Chaque plan du film est un coup de feu. Alors pour moi, ce coup de feu m’a fait penser « ok, je vais te payer 100 dollars pour ce coup de feu ; je ne vais pas payer 5000 dollars pour un parcours ». Et le film est une somme de coups de feu et de coups. Et de coups durs ! Parce que c’est une réalité dure.
On ressent cet impact en regardant le documentaire. Dans toute l’Amérique latine, y compris au Pérou, nous avons subi l’opération Condor, qui nous marque encore beaucoup. Nous ne pouvons pas dire que c’est du passé, nous vivons toutes les conséquences de sa présence, et le discours de l’époque perdure. Ce documentaire ne divague pas, il dit directement ce qui s’est passé et comment. Si, en tant que réalisatrice, je devais traiter tout ce matériel sur l’histoire de mon pays, cela m’affecterait certainement émotionnellement. Comment te sens-tu, toi qui ne regardes pas seulement un matériel pour travailler sur le plan artistique, mais quelque chose qui touche directement au cœur de notre indignation ?
Je pense qu’être entouré de ces images pendant si longtemps n’est pas sain. À un moment donné, dans mon atelier, le visage de Stroessner était partout. Je connaissais aussi les visages des autres jeunes officiers. Je les reconnaissais, je connaissais leurs noms. Et pourquoi savais-je tout cela ? Il y avait là comme une forme de questionnement : « Qu’est-ce que je fais de ma vie ? » Mais j’ai beaucoup appris, et pas seulement sur l’histoire. Car l’histoire est incroyable et pleine de nuances, mais ce n’est pas un film historique : c’est un film de sentiments et de souffrance. J’ai beaucoup appris des regards, des gestes. Je voulais m’approprier l’image. Ces enfants qui nous regardent sur les images, qui sont-ils ? Ils ont été exposés à ce discours en boucle pendant 35 ans. De toute évidence, le pays en serait là aujourd’hui si cette génération l’avait consommé pendant si longtemps. Le Paraguay est l’un des pays les plus sexistes de la région, avec l’un des taux de suicide les plus élevés. C’est aussi l’un des pays où le niveau d’éducation est le plus bas. Je ne veux pas être négatif envers mon pays d’origine ni envers l’endroit où je vis, mais je crois que seul ce genre d’exercices peut nous permettre de briser ce « quelque chose » qui nous habite. Je ne voulais pas rester « à la place des victimes » ou « des guérilleros », car je souhaitais mener une analyse plus large. Il ne s’agissait pas de désigner le méchant. Le méchant se dévoile et se décompose de lui-même.
Oui, car réaliser un film implique un processus non seulement créatif, mais aussi émotionnel.
Bien sûr ! Car, au fond, qu’est-ce que faire un film ? On peut faire un film pour gagner sa vie, pour vivre, pour exprimer ce qui se passe en soi. On peut faire un film pour divertir, pour faire rire, ou un film pour faire pleurer. On peut faire un film sur tout ce qui nous passe par la tête. Mais je crois que les bons films, ou du moins ceux qui m’intéressent, sont ceux qui résonnent en moi, mais aussi dans un contexte politique et un lieu précis. Autrement dit, d’où est-ce que je parle ? D’où viennent mes émotions ? Je ne savais pas, mais quelque chose me préoccupait, alors j’ai écouté, pour voir ce qui se passerait. J’ai laissé cette sensation mûrir un moment. Par ailleurs, je travaillais dans une agence de publicité…
Donc, dans un domaine complètement différent…
Oui, je travaillais pour gagner ma vie, comme tout Latino-Américain. Qui gagne sa vie comme réalisateur ici ? Je travaillais dans une entreprise pour vivre, payer mon loyer, et en même temps, je réalisais le film. Comprendre comment se font les films latino-américains, trouver le bon moment pour s’y connecter, a été tout un processus pour moi. Mais il y avait quelque chose en moi et dans le film qui m’a saisi. Il me disait : « Oui, c’est ça, je vais y aller et je vais faire naître ce son en moi.»

Vous avez probablement déjà entendu parler de la loi anti-cinéma au Pérou, qui donne à l’État le contrôle et le pouvoir de désapprouver et de discriminer différents thèmes et films produits dans le pays. Au Paraguay, votre cinéma bénéficie-t-il d’une quelconque protection ? Ou est-il lui aussi en situation de vulnérabilité ou sans protection ?
La création de l’Institut audiovisuel est assez récente. Il a sept ans. Notre projet a été approuvé par l’Institut du film. Il bénéficie de leur soutien. Ils comprennent de quoi je parle. Nous ne subissons aucune décision gouvernementale quant à ce qui est dit ou non. Dans d’autres domaines, comme celui des espaces culturels, nous subissons actuellement une persécution politique des espaces qui ne correspondent pas aux intérêts commerciaux actuels. Cela n’a rien à voir avec le cinéma, mais cela concerne le monde culturel, qui y est d’une certaine manière lié. Aujourd’hui, nous ne subissons pas le même niveau d’intervention qu’ici au niveau du cinéma, mais nous en subissons au niveau culturel. Les espaces culturels, les espaces de résistance, les espaces où s’expriment les voix dissidentes face au gouvernement actuel, sont aujourd’hui persécutés, condamnés et emprisonnés.
Pensez-vous que vous, ou le film, pourriez subir des répercussions négatives ?
Il y a eu des cas dans d’autres domaines artistiques qui ont eu des répercussions négatives, mais comme je n’ai pas d’exemple similaire dans le cinéma, je ne sais pas ce qui pourrait arriver. Des films ont été réalisés contre d’autres présidents, principalement liés au trafic de drogue et à des choses de ce genre, et rien de majeur ne s’est produit. On verra, mais je ne pense pas qu’il se passera quoi que ce soit. Vivons-nous en démocratie ? Du moins, j’aimerais le croire.
Nous essayons toujours de faire en sorte que ce soit le cas, ne serait-ce que par nos actions, à défaut d’influencer les décisions des autorités. Ce film ouvre la voie à une démocratie vécue pleinement, car il nous permet d’aborder l’oppression, la dictature, le fascisme, et de souligner à quel point il est choquant de voir un nazi du Troisième Reich vivre au Paraguay.
En effet, ils lui ont donné un passeport paraguayen. Nous le montrons dans le film. J’ai du mal à parler du Paraguay, ce pays où je vis, où je suis né, mais c’est un refuge idéal. Un endroit où l’on est introuvable. Le Paraguay n’a pas encore Google Street View ! On y croise toujours des personnages étranges, et on se demande : « Que fait ce Suédois au Paraguay ? » Il y a de nombreux cas comme celui de Mengele. D’ailleurs, la sœur de Nietzsche a créé la première communauté antisémite d’Allemands hors d’Allemagne, au Paraguay, au début du XXe siècle. C’est un point de transit, un fief mafieux, une plaque tournante du trafic, situé entre les deux plus grands pays de la région, l’Argentine et le Brésil. C’est un lieu conflictuel, en ce sens. Situé au cœur de l’Amérique latine, pris en étau entre les deux superpuissances, et enclavé, contrairement à l’Uruguay. L’affaire Mengele n’est qu’un exemple, mais nous savons tous que des choses se passent au Paraguay. Il existe une importante communauté nazie au Paraguay. Je pense que ce qui surprendra le moins les Paraguayens [en voyant le documentaire], c’est l’histoire de Mengele. Le Paraguay est un endroit où l’on peut se cacher et où personne ne peut vous trouver.
Et comment faites-vous pour garder la foi ?
Grâce à la communauté d’amis, la communauté d’artistes, la communauté de créateurs et de penseurs, qui est très vaste et exerce une forte attraction. Je pense que l’oppression est importante, mais les penseurs sont très brillants, et nous formons un groupe ; je ne suis pas le seul à faire cela. Il y a des gens qui font ça depuis longtemps dans d’autres domaines, parfois même plus engagés politiquement que moi, au théâtre, en littérature, dans les arts visuels et en danse. Au Paraguay, de nombreuses expressions artistiques s’épanouissent, portées par des personnes plus jeunes ou un peu plus âgées que moi, et c’est ce qui nous donne espoir. Nous croyons au changement. Je crois au changement.
Allez-vous poursuivre vos projets de films et d’archives, ou avez-vous une préférence entre les deux ?
Honnêtement, je souhaite prendre un peu de distance avec la dictature. Je veux explorer d’autres pistes, mais j’ai aussi beaucoup de matière que je veux continuer à travailler. Je crois avoir trouvé dans le film quelque chose de très personnel, quelque chose que je ressens profondément. J’y ai trouvé une esthétique, quelque chose que je recherchais, et je vais continuer à l’explorer. Non pas en la remaniant, mais en essayant de l’enrichir. J’aime beaucoup le travail d’archives. Je n’aime pas tourner, alors je ne sais pas, peut-être qu’un jour je ferai un film de fiction, mais je n’ai pas beaucoup d’expérience dans ce domaine ; je n’ai jamais travaillé avec des acteurs.
De plus, la fiction a un début et une fin, alors qu’un documentaire est infini.
Il est infini, c’est un film sans fin ! J’aime explorer le cinéma. Je dirige également un festival de cinéma au Paraguay, l’ASUFICC. Cette année marque sa cinquième édition. Je fais partie de l’équipe de programmation et je suis cofondateur du festival. Nous nous efforçons toujours de donner de la visibilité aux projets paraguayens et latino-américains au Paraguay. Nous grandissons. Nous sommes petits, mais nous avons de grandes ambitions.
Par Mariale Bernedo / cinencuentreo / Traduit par Kinolatino
Entretien avec Simón Mesa Soto, réalisateur originaire d’Antioquia, au sujet de son film « Un poète », lauréat du Prix du Jury dans la section « Un Certain Regard » du Festival de Cannes et projeté dans les cinémas colombiens.
Comment décririez-vous votre film « Un poète » ?
« Un poète » raconte l’histoire d’un homme d’une cinquantaine d’années qui vit chez sa mère et qui est un peu le mouton noir de la famille. Artiste qui se considère comme un poète, il traverse une crise existentielle et se sent en échec. Le personnage a publié quelques livres à l’âge de 20 ans et se débat avec un dilemme existentiel : quel sens a-t-il donné à sa vie ? Sa passion pour les arts est immense, mais en réalité, il est au chômage et croule sous les problèmes. Sa famille se dispute souvent avec lui ; ils veulent le mettre à la porte, mais sa mère est surprotectrice. Il est contraint de devenir professeur de lycée à Medellín, où il rencontre une jeune fille très talentueuse. Il souhaite l’aider à devenir une grande poétesse, espérant ainsi racheter ses propres échecs à travers elle. Le film se révèle être une série d’aventures qui illustrent les dilemmes de l’art et de la poésie. C’est une comédie ; on y rit et on s’amuse beaucoup, mais il comporte aussi des moments tragiques et des scènes d’une grande intensité émotionnelle. Il se situe à la frontière entre la tragédie et la comédie.

D’où est venue l’idée de « Un poète » ?
En Colombie, être artiste est un métier complexe. J’ai consacré beaucoup de temps au cinéma et j’ai connu des moments de grande frustration et de grandes difficultés. Avec l’âge, on vieillit, on commence à penser à la stabilité financière et on se dit : « Waouh, le monde de l’art est compliqué ! » Il y a environ quatre ans, j’ai traversé une période de frustration et j’ai voulu transformer cette frustration en quelque chose de spécial. Je me suis dit : « Je vais créer un personnage qui incarne et exprime mes frustrations et celles que nous, artistes, connaissons. » Mais je voulais le faire à travers la comédie.
Et pourquoi la poésie ?
J’ai pensé à la poésie parce que j’avais assisté à des lectures, j’avais découvert la poésie à Medellín et à Bogotá, et j’avais trouvé que les poètes étaient encore plus rêveurs, plus fantasques, plus utopiques dans leur manière d’appréhender leur art. J’ai donc trouvé très beau et intéressant de raconter l’histoire d’un poète. À travers ce poète, j’ai aussi canalisé tous mes dilemmes d’artiste, mais je voulais que ce soit un film agréable à réaliser et à regarder. Pendant le tournage, on a beaucoup ri. Je voulais renouer avec l’effervescence du cinéma, avec la comédie et le rire, et rire de moi-même en tant qu’artiste et de tout le reste. C’est ainsi qu’est née l’histoire et le scénario que j’ai écrits pendant plusieurs années. J’ai tout fait avec une équipe formidable. On a ri aux éclats pendant le tournage. C’est incroyable qu’une œuvre aussi personnelle puisse toucher autant de gens. Et c’est parce que nous aussi, nous avons ces dilemmes.
Comment le film a-t-il été accueilli ?
Je pense que les spectateurs sont sortis de la salle très émus. Et beaucoup l’ont déjà vu. D’ailleurs, nous étions le deuxième film le plus rentable au box-office colombien le week-end dernier, le jour de sa sortie. Ça nous a beaucoup surpris, et nous avons reçu des messages de personnes profondément touchées par le film. Nous avons ressenti une véritable joie et un bouche-à-oreille magique autour du film.
Vos précédents projets cinématographiques étaient très différents d’« Un poète » Qu’avez-vous ressenti en prenant le risque de réaliser une comédie en Colombie ?
Mes autres films ont des tonalités très différentes, et je voulais bousculer un peu les choses, renouer avec cette passion, avec ce jeune homme de 20 ans qui a commencé à faire des films et qui a encore cette étincelle. Je voulais que cette étincelle grandisse à travers un film très inhabituel, mais je voulais aussi qu’il unisse deux mondes : Un film aux fortes valeurs cinématographiques, mais qui n’oublie pas le dialogue avec le public et qui propose un humour particulier et unique. Un humour aussi mélancolique. Et surtout, un film très libre, puisant dans de nombreuses sources, comme un jeu. Pour moi, il s’agissait de ne pas me demander pourquoi je le faisais, mais plutôt, au-delà de moi-même, de mes désirs et de l’équipe, de créer quelque chose de spécial.
Comment le personnage principal a-t-il été choisi ?
Le personnage principal devait initialement être un acteur professionnel, nous avons donc organisé un casting très long. Nous avons rencontré de nombreux acteurs professionnels, mais nous avons également recherché des personnes issues du même monde artistique et poétique : écrivains, musiciens, enseignants et poètes. Au cours de ces recherches, un ami m’a envoyé le profil d’un de ses proches, Ubeimar Ríos. Nous lui avons fait passer un essai, et au premier abord, il ne m’a pas semblé caler dans le personnage. Il m’a fallu un certain temps pour réaliser qu’Ubeimar était le poète. Mais peu à peu, j’ai appris à le connaître, et sa personnalité, sa façon de s’exprimer, suscitaient une grande empathie chez les gens. Ce n’est pas un acteur, mais il a ce don d’être devant la caméra, d’incarner véritablement le personnage. Et il a accompli quelque chose de magnifique, d’inattendu pour moi : il a légèrement modifié le personnage que j’avais en tête et a créé cet Óscar Restrepo qui lui est propre. Les gens le reconnaissent dans leurs connaissances, dans leur famille, dans leurs oncles. Ces décisions que l’on prend, au début on ne sait pas si elles sont bonnes ou mauvaises, ce sont des risques, mais elles finissent par toucher les gens. Maintenant, ils le voient, l’aiment, le prennent dans leurs bras et sont émus par lui. C’est vraiment beau.
Un autre personnage très émouvant est Yurlady, la jeune étudiante qui écrit des poèmes. Comment a-t-elle été créée ? Que représente-t-elle ?
Yurlady représente beaucoup de personnes pour moi ; elle représente tous ceux qui sont sensibles à la beauté de la poésie. Pour moi, Yurlady était l’art à l’état pur, en quelque sorte. Parce que souvent, lorsqu’on fait des films ou qu’on crée de l’art, on s’éloigne de son essence au fil des années. À cause de mécanismes plus commerciaux ou de l’industrialisation des arts, il faut toujours préserver cette Yurlady, ce sentiment qui vous relie si profondément à l’art, au cinéma, à la raison pour laquelle vous l’aimez tant.

Quand un film sort et se démarque dans les festivals, le travail en coulisses est quelque peu négligé. Comment avez-vous obtenu le financement pour ce film ?
En effet, la sortie d’un film est en réalité l’une des périodes les plus courtes : les festivals et l’exploitation en salles sont très rapides comparés à tout le travail préparatoire. Cela prend des années. Depuis 2021, nous écrivons le scénario, puis nous avons cherché des financements. C’est la partie la plus fastidieuse de la réalisation d’un film, car il faut deux ou trois ans pour trouver des ressources, pour démarcher. Nous avions besoin d’un budget qui nous permette de réaliser un scénario très complexe, avec de nombreuses facettes et une distribution importante. En tant que cinéaste, il faut donc faire des sacrifices, tout en étant très persévérant, discipliné et travailleur. Le film est né des frustrations engendrées par ce même processus.
Avez-vous réussi à retrouver le plaisir de faire des films ?
Oui, je voulais que ce soit un plaisir. J’ai ri en l’écrivant et j’ai aussi ri pendant le tournage. J’aime ce contraste. C’est difficile, c’est complexe, mais c’est magnifique ; c’est un privilège de faire des films. Surtout, c’est incroyable de voir que ce plaisir se reflète dans le nombre de spectateurs qui vont au cinéma. Au-delà des festivals, des critiques et des prix, ce qui nous comble le plus, c’est que le film parle au public et que le public réagisse positivement. Je suis très enthousiaste car j’ai l’impression de renouer avec cette jeune personne que j’étais, qui a commencé à faire des films avec tant de passion, tant d’enthousiasme, et c’est à vous de préserver cet héritage.
Quelle est votre vision du cinéma colombien en tant que cinéaste ?
Je crois qu’il ne faut pas se fixer de limites lorsqu’il s’agit de raconter des histoires. La matière première du cinéma, c’est la réalité. Et la réalité colombienne est multiple : elle englobe les trafiquants de drogue, les poètes et tout ce qui se trouve entre les deux. Et je ne pense pas que raconter la réalité soit un problème. Ce que je veux dire, c’est que nous devons raconter toutes sortes d’histoires. Je crois que le cinéma colombien doit refléter cette réalité, et il le fait. Ce dont nous avons besoin, c’est d’un public qui regarde les films et qui se sente plus profondément concerné par ses propres histoires. Quand on regarde un film américain, par exemple, comme ceux de Martin Scorsese, un cinéaste qui aborde toujours la question de la violence à New York, on l’apprécie. Et peut-être qu’on n’apprécie pas autant les films d’ici parce qu’il est plus douloureux de voir nos propres réalités. Mais en général, je pense que le cinéma colombien est très diversifié. Il y a une recherche, pas seulement la mienne, mais celle de nombreuses personnes, qui tente d’explorer différentes formes et réalités de la société colombienne au cinéma.
Entretien réalisée par Sofía Gómez Piedrahíta / Lapatria / Traduit par Kinolatino
Six décennies après la remise du prix à Araya sur la Côte d’Azur, sa réalisatrice Margot Benacerraf se souvient de ce qui a motivé ce film, de sa production et du tournant qu’il a marqué dans sa carrière et dans l’histoire du cinéma latino-américain.
Année 1959. Au Venezuela, Rómulo Betancourt accède à la présidence après avoir remporté les élections du 7 décembre 1958. Il devient ainsi le premier président de l’ère démocratique inaugurée après le départ du pouvoir de Marcos Pérez Jiménez le 23 janvier 1958.

En France, le Festival de Cannes annonçait son palmarès le 15 mai : la Palme d’or du meilleur film était décernée à Orfeu Negro de Marcel Camus. François Truffaut était récompensé comme meilleur réalisateur pour Les 400 coups, film qui remportait également le prix OCIC. Nazarin de Luis Buñuel remportait le prix international. Et Araya, de la vénézuélienne Margot Benacerraf, a été acclamé par les spécialistes qui lui ont décerné le Grand Prix de la Critique internationale (Fipresci), ex-aequo avec Hiroshima mon amour (Alain Resnais), et le Prix de la Commission technique supérieure, « pour le style photographique des images qui met en valeur la qualité de l’ambiance sonore ».
À une époque où il n’existait aucun soutien officiel à la réalisation cinématographique, ni organisme régissant le cinéma, et encore moins une tradition vénézuélienne de femmes réalisatrices, Margot Benacerraf s’impose en Europe et surprend, avec une œuvre qualifiée de poétique. « Soixante ans ont passé et les gens n’ont toujours pas compris qu’Araya n’est pas un documentaire mais un récit poétique, tel qu’il a été accepté à Cannes… Je n’ai rien contre le documentaire, je l’ai toujours défendu, mais c’est un genre qui vous limite d’une certaine manière, et Araya est une tentative de transcender le documentaire. Araya, sous son apparente simplicité, est une chose très compliquée car tout en cohabitant et en utilisant les codes du néoréalisme italien, il me donne une liberté en tant que réalisatrice », commente la cinéaste et gestionnaire culturelle, née en 1926.
Benacerraf, d’origine juive séfarade, avait déjà commencé à s’ouvrir des portes sur la scène internationale avec son documentaire Reverón (1952), qui remporte un grand succès au Festival de Berlin (juin 1953) et au Festival d’Édimbourg (août 1953) ; Il est projeté à la Cinémathèque française et à la Cinémathèque belge du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, puis sélectionné en novembre 1953 par l’Association française des critiques de cinéma et de télévision pour l’inauguration de la salle de cinéma d’art et d’essai du Studio de l’Étoile à Paris, avec des diffusions spéciales à la télévision française et allemande.
Araya arrive à la dernière minute à Cannes et laisse beaucoup de gens bouche bée, obtenant l’approbation unanime de la critique internationale. « En 1959, nous étions en phase de post-production (synchronisation, montage), et un producteur français a été tellement enthousiasmé par le film qu’il m’a dit qu’il voulait en être le coproducteur. Il a alors parlé d’Araya au Festival de Cannes, où il était très difficile d’y accéder, et on lui a répondu que si le film était prêt et doublé ou sous-titré en français, il serait soumis à un vote lors d’une sorte de comité de sélection. Au début, il y avait beaucoup de doutes, car c’était un film vénézuélien, un pays très lointain pour eux, qui ne comptait aucun acteur connu à leurs yeux. Bref, il y a eu un premier moment de difficulté, mais quand ils ont vu le film, la seule chose qui manquait était le texte, et je l’ai fait tout de suite avec Laurent Terzieff, un acteur français qui a immédiatement fait l’enregistrement… Imaginez la surprise quand, à deux jours de la clôture du Festival, la presse a commencé à dire que l’apparition d’Araya avait tout changé et qu’on lui avait décerné le prix suprême. Les gens étaient bouleversés », se souvient Benacerraf.
En effet, la cinéaste a suscité de nombreuses réactions positives et a fini par être considérée comme la représentante en Amérique latine de la Nouvelle Vague, menée en Europe par des réalisateurs tels que Claude Chabrol, Jean-Luc Godard et François Truffaut. « (Araya) est le premier long métrage de Margot Benacerraf, une cinéaste d’une trentaine d’années qui a étudié à Paris et qui nous montre que la Nouvelle Vague dont on parle tant est également arrivée en Amérique du Sud », a écrit Ugo Casiraghi dans L’Unita-Italia. « La beauté des images d’Araya, la lenteur concentrée de son développement et la sensibilité de la musique de Guy Bernard font de cette fresque, composée comme un hommage et comme une requête, une œuvre de grande qualité », a écrit Henry Magnan dans Les Spectacles de Paris. « Tôt ou tard, j’en suis sûr, Araya s’imposera comme une grande œuvre auprès du public qui aime et comprend le cinéma », a déclaré Georges Sadoul dans Les Lettres Françaises. « Araya est un long poème sur le sel, son travail et l’effort… Ses images sont d’une beauté tragique », a publié le journal Libération.
Le président du Venezuela, Rómulo Betancourt lui-même lui envoya une lettre dans laquelle il écrivait : « Recevez mes félicitations, en tant que Vénézuélien et président de la République, pour le succès mérité remporté lors du récent Festival grâce à la présentation de ce document poignant sur la réalité vénézuélienne qui, par son austère véracité, non dénuée d’une pure beauté, a su impressionner un public aussi exigeant. Je crois sincèrement que des œuvres comme la vôtre constituent une propagande évidente et positive pour la compréhension de notre pays sur la scène internationale ».
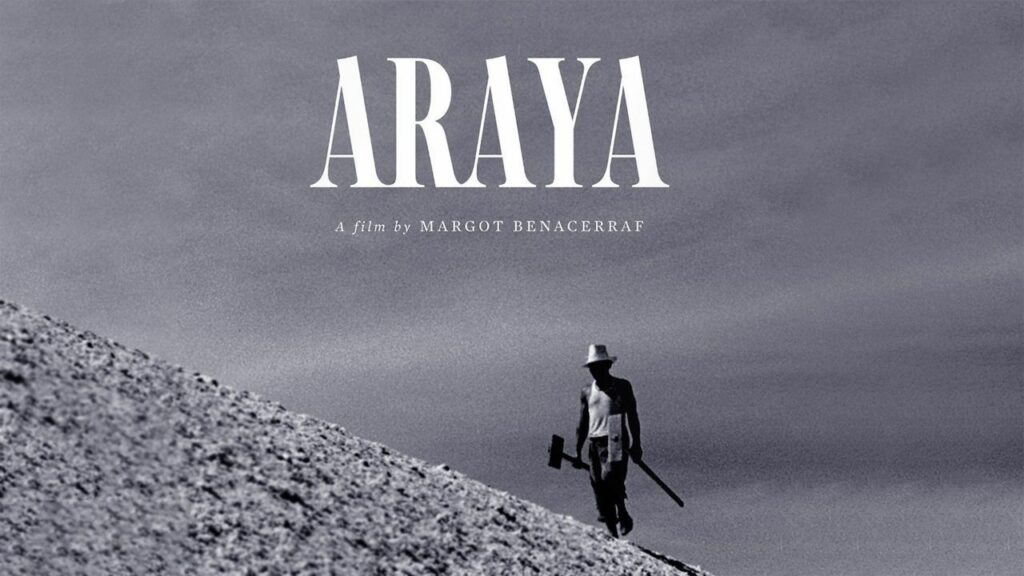
Un conte de Noël
Margot Benacerraf produirait avec Miguel Otero Silva la version cinématographique de Casas Muertas (1955). Elle allait même se rendre au Mexique pour chercher une coproduction, mais l’auteur décide de commencer ce qui allait être son troisième roman, Oficina Nro. 1. « J’avais très envie de travailler et j’ai dit : « Pendant que Miguel fait ses recherches, je vais chercher un autre sujet ». Et j’ai eu l’idée d’un projet intitulé Tríptico de Navidad, qui comprenait trois contes se déroulant à Noël dans trois régions du Venezuela : les plaines, les Andes et la côte. Il me manquait l’ambiance de la côte, mais je ne voulais pas tourner dans un endroit avec des palmiers et du soleil, alors j’ai commencé à chercher un autre lieu. Un jour, j’ai vu dans un magazine des pyramides de sel qui m’ont beaucoup impressionnée. J’ai interrogé les gens, mais personne ne savait où elles se trouvaient, jusqu’à ce que je finisse par le découvrir : il fallait aller à Cumaná pour y arriver. On m’a dit : « Tu attends un ferry qui transporte de la nourriture, des bananes et d’autres choses. On ne sait pas quel jour il arrive. » Je suis donc partie pour Araya en ferry un après-midi, après deux jours d’attente. Quand je suis arrivée, c’était l’heure où le soleil est le plus bas : les murs du château se reflétaient, c’était impressionnant ! », raconte l’artiste, tandis que ses yeux semblent refléter à nouveau la dorure sur les ruines de l’ancienne forteresse qui protégeait la saline, dans cet environnement désolé et inhospitalier.
« Un jour, des hommes ont débarqué sur ces terres arides, où rien ne poussait, où tout n’était que désolation, vent et soleil. Ils ont appelé ces terres Araya », raconte José Ignacio Cabrujas au début du film dans la version espagnole. Les images et la musique plongent le spectateur dans une atmosphère presque onirique et primitive, où une vérité se dévoile peu à peu. Araya est la métaphore de la réalité sud-américaine où la main de l’homme, celle du conquérant et celle de l’indigène, transforme le paysage, pour le meilleur ou pour le pire, à la recherche du profit personnel.
La réalisatrice choisit des personnages de la péninsule, membres de trois familles, sauniers et pêcheurs, de différents villages, Manicuare, Araya et El Rincón. Pendant une journée, elle dépeint le quotidien de ces personnes, transformant en art la simplicité de leurs vies. Les séquences dans lesquelles les sauniers construisent les pyramides, le processus de salage du poisson avec les mouvements rythmés des hommes pulvérisant le sel avec des bâtons, ou la scène de la grand-mère avec sa petite-fille apportant des coquillages (au lieu de fleurs) au cimetière local sont particulièrement belles.
À la fin de l’année 1957, Margot Benacerraf a consulté toute la documentation historique existante dans les archives dites « Archivos de Indias » de Séville, Madrid et Amsterdam sur les salines d’Araya, et a étudié attentivement l’environnement et le mode de vie des habitants de cette ancienne saline située sur une péninsule au nord-est du Venezuela, qui, cinq siècles après son occupation par les Espagnols, continuait d’être exploitée à la main. « J’ai eu la chance de filmer à cheval, comme si j’étais arrivée avec la Conquête, de passer par un travail manuel et un quotidien qui se répétait depuis 500 ans, avec une vie très simple, mais très spéciale, jusqu’à l’arrivée des machines qui industrialisent cette région du Venezuela, mais ne tiennent pas compte du facteur humain », explique la cinéaste.

« Gestes du sel. / Roue du sel du temps qui ne s’arrête jamais. / Or blanc de la mer. / Sel lavé par la sueur des hommes. / Sel des sauniers. / Cristal dur du vent », récite le scénario du film tout en montrant les chorégraphies des hommes soulevant les imposantes pyramides de sel.
Araya apporte une grande satisfaction à Margot Benacerraf, mais aussi une maladie qui l’empêche de profiter pleinement des fruits de son succès. Diagnostiquée avec la dengue, la cinéaste termine le film avec de la fièvre, puis, convalescente, elle doit rester au moins un an à l’écart des offres qui lui sont faites à la suite du prix remporté à Cannes. Les temps difficiles que traversait l’industrie cinématographique ne lui ont pas permis de concrétiser bon nombre des propositions qui lui ont été faites. De plus, vers 1965, elle reçoit une offre qui l’éloigne d’une carrière cinématographique en Europe pour lui ouvrir une brèche au Venezuela en tant que responsable culturelle.
Grande amie de Mariano Picón Salas, elle reçut un télégramme daté du 1er janvier 1965, à 23 heures, dans lequel elle était invitée à participer au tout nouvel Institut national de la culture et des beaux-arts (Inciba) aux côtés d’autres créateurs tels que Miguel Otero Silva et Alejandro Otero. « J’étais installée à Paris depuis environ sept ans et j’ai vraiment pensé à refuser : au Venezuela, il était impossible de faire du cinéma, chaque fois qu’on tournait un film, on était épuisé, c’était un pays qui n’offrait rien, il n’y avait aucune stimulation. Le 1er ou le 2 janvier 1965, dès l’ouverture de l’ambassade à Paris, j’ai demandé à parler à Don Mariano, et Juan Oropesa m’a dit que Don Mariano était décédé à minuit le 1er janvier 1965. La seule chose qu’il a faite ce jour-là a été de m’envoyer un message pour demander de l’aide. Comme vous pouvez l’imaginer, cela m’a beaucoup ému, car je lui avais écrit que je ne viendrais pas, que je commençais une nouvelle vie, et bien sûr, cette nouvelle m’a mis dans une situation difficile », se souvient Benacerraf, qui avait prévu de venir au Venezuela pour un an, et qui, finalement, est resté dans le pays, travaillant dans la gestion culturelle.
Elle dit ne pas regretter ce qu’elle a accompli : elle a créé la Cinémathèque nationale, mis en œuvre le Plan Pilote Amazonas et créé l’École de cinéma, en plus de son travail à l’Athénée de Caracas. Elle regrette toutefois de ne pas avoir consacré plus de temps à sa grande passion. « Peut-être qu’après un certain temps, j’aurais dû abandonner la promotion culturelle et revenir au cinéma. Quand on se lance dans la création, il faut mettre les choses en place, les faire fonctionner, et cela ne se fait pas en un jour », confie-t-elle, tout en revenant sur Araya, le film et la péninsule.
« Je suis allé les voir plusieurs fois, j’ai gardé un lien avec eux. Beaucoup de choses ont changé. C’est très triste. Maintenant, vous voyez une personne appuyer sur le bouton d’une machine tandis que les autres sont dans un bar. La famille s’est dissoute, l’un est parti à Margarita, l’autre à La Guaira. C’est pourquoi la question finale du film est posée ainsi et malheureusement, je pense que cela a été le cas. Ce n’est pas que l’industrialisation ait apporté une vie différente à Araya, qui reste stérile, aride, sans fleurs… »
« (Explosion) Soudain, sur cette terre désolée, dans l’ancienne Araya, 450 ans se font face. La peine des hommes va-t-elle disparaître ? Le monde ancien pourra-t-il changer ? Les machines pourront-elles enfin remplacer les bras de Benito, Beltrán et Fortunato, et construire les pyramides ? S’agit-il des dernières maras ? Est-ce la fin du cycle du sel ? », conclut le film avec des images de machines lourdes creusant, broyant, transportant l’or blanc de la mer.
Le regretté Pablo Antillano a écrit à propos de Margot Benacerraf et de son film Araya : « Le contact direct avec les sauniers et les pêcheurs, la connaissance approfondie de leur cycle économique, de leurs gestes quotidiens, de la complexité de leur vie, lui ont permis d’aller plus loin dans la méthode, dans les formes et dans les conclusions. Le résultat est un film à connotation politique, sans schématisme, qui semble avoir été réalisé aujourd’hui, après toute cette longue expérience des années 60 qui nous a amenés là où nous en sommes. Pourtant, Araya a été tourné en 1957 et monté en 1958. Appelons cela de la sensibilité anticipatrice ».
À la question de savoir s’il y aurait de la poésie dans l’Araya d’aujourd’hui, Margot Benacerraf répond par un « je ne sais pas », avec un regard perdu entre nostalgie et désir. Araya, le film, est sans aucun doute de la poésie, mais aussi un exploit dans la carrière de la cinéaste et dans l’histoire du cinéma vénézuélien.
Par Ángel Ricardo Gómez / Rédaction El Estímulo, mai 2019 / Traduit par kinolatino
Entre le monde dit civilisé et le monde des légendes et du folklore
Ce film est une incursion bienvenue dans le cinéma de genre (science-fiction, fantastique et horreur) au Brésil. Mais contrairement à ce qui est de plus en plus fréquent, où les jump scare font fusion, les bandes sonores stridentes et les montages hachés sont presque devenus la norme, dans Pacto da Viola, le rythme est différent — pour notre grand bonheur. Le réalisateur et scénariste Guilherme Bacalhao — un nouveau venu dans le format, mais loin d’être un débutant — fait preuve d’une curieuse certitude quant à ce qui l’attend, tant en ce qui concerne le déroulement de l’histoire que le développement et la consolidation des personnages impliqués dans les événements dont nous sommes témoins. Les liens entre eux sont solides, même s’ils se manifestent dans des dynamiques différentes : il y a l’étranger (ou presque) qui ne croit pas grand-chose, ainsi que les anciens qui répètent à demi-mot ce qu’ils savent sur ce qui n’est pas vu ou même mentionné. Entre soupçons et suggestions, le mystère se construit. Sans révélations évidentes ni effets fugaces, mais, en revanche, en obtenant un effet plus pervers et durable.

Nous parlons du « mal », le secret à peine caché qui se trouve derrière les événements principaux de Pacto da Viola. Lorsqu’il apprend que son père est malade, Alex (Wellington Abreu, de O Espaço Infinito, 2023) décide de quitter — bien que temporairement — la vie à la capitale pour retourner à la campagne. Dans la petite ville d’Urucuia, celle de son enfance, en pleine transformation. L’agro-industrie s’est emparée de tout et de tous — les jeunes qui restent dépendent de « la ferme » pour toute forme de travail et de subsistance, la géographie du lieu est également soumise à la volonté des « patrons » — et l’espoir de maintenir les anciennes traditions et coutumes se perdent. Le garçon rêve de devenir chanteur de Sertanejo (une country brésilienne), mais il n’a qu’une vieille guitare et quelques CD enregistrés à compte d’auteur, un produit qui n’intéresse personne. Alors, comment éviter le même sort qui s’abat chez tous ceux qui l’entourent ? Deux options : se résigner ou fuir ?
La relation qui se dévoile peu à peu entre le monde dit civilisé et le monde des légendes et du folklore qui alimentent les croyances des habitants est intéressante. Lorsqu’il arrive et trouve son père alité, le premier réflexe d’Alex est de l’emmener au centre de santé, un projet vite écarté par la tante chargée de soigner le malade. Il y a d’autres choses à essayer d’abord. Une forte prière, un rituel pour « recoudre » le corps, la consécration du bœuf dédié aux saints. Mais rien n’arrête le bruit du serpent à sonnette qui se rapproche de jour en jour. Personne ne l’entend plus, mais le vieil homme sait que son heure approche. Qu’a-t-il pu faire pour avoir si peur de payer cette prétendue dette ? La révélation vient au jeune homme d’une manière biaisée : et si le contrat conclu il y a tant d’années ne l’avait pas été avec celui d’en haut, mais plutôt avec une force d’en bas, encore plus séduisante et pleine d’arrière-pensées ? Est-ce la raison pour laquelle le père n’a plus jamais joué de la guitare après la mort de sa femme ? Le non-croyant se retrouvera donc lui aussi croyant.

Le dilemme de l’un se rapproche de l’autre, faisant apparaître des parallèles entre hier et aujourd’hui. En effet, si le vieil homme ne veut plus utiliser le don qu’il a reçu comme guitariste, principalement parce qu’il nie le prix élevé qu’il lui a coûté, qu’aurait à perdre le fils, qui ne demande qu’à profiter du même talent que celui qui a été dédié à son père ? Travaillant dans des immenses plantations de soja, au milieu de pesticides toxiques et de silos sans fin dans lesquels on peut se perdre jusqu’à ne jamais être retrouvé, le rêve de sa cousine de partir semble n’être qu’un rêve éveillé. Lorsque le protagoniste apprend que le diable se cache dans un trou d’une petite église oubliée des fidèles, c’est là qu’il va. Au début, c’est presque une blague, une farce sans grandes conséquences. Mais quand les options s’épuisent, c’est la seule solution qui lui reste. Et pour sauver l’un, il faut condamner l’autre, comme un échange de bâtons — et de responsabilités.
Le pacte qui donne son titre au film est une menace qui pèse sur les protagonistes du début à la fin, et la possibilité (ou non) qu’il se concrétise est l’une des réussites de Pacto da Viola. En utilisant une narration lente et qui reflète le manque d’horizon, tout en construisant sa tension davantage par la manipulation du point de vue et le pouvoir de suggestion, Guilherme Bacalhao offre à ses spectateurs un exercice d’atmosphère qui n’est peut-être pas facile à apprécier et à reconnaître, mais qui se confirme solidement lorsqu’elle s’est ancrée dans l’expérience de ceux qui la regardent. Effort constant d’une narration, film à la limite de l’artisanat, mais qui indique une voie intéressante et qui n’exige pas une acceptation inconditionnelle, mais ceux qui l’empruntent en sortent transformés. Comme un ensemble de parties, précieuses si elles sont séparées, et d’une force indéniable si elles sont réunies.
Par Robledo Milani / Papo de Cinema / traduit par Kinolatino
C’est un film collectif qui se construit à partir de différents points de vue
Felipe Morgado, documentariste, membre du collectif MAFI depuis 2014, où il a mené des résidences artistiques à travers le Chili en mettant l’accent sur le cinéma communautaire. Il a produit le court métrage Fantasmagoria (2022) de Juan Francisco González, présenté en avant-première à DocLisboa, et Pampas Marcianas, d’Aníbal Jofré, présenté en avant-première à FIDOCS (2023). Oasis est son premier film en tant que réalisateur.
Coréalisé par Tamara Uribe et Felipe Morgado, le nouveau documentaire du Colectivo MAFI présente une vision particulière de l’explosion sociale au Chili en 2019, de la formation de la Convention constitutionnelle et du résultat du plébiscite. Produit par Alba Gaviraghi et Diego Pino Anguita, le documentaire enregistre diverses manifestations publiques dans le contexte de l’explosion sociale et de la création de la Convention constitutionnelle, construisant un paysage audiovisuel du Chili récent, où il semble que l’humour et l’absurdité fassent partie de multiples événements politiques qui ont donné le ton dans notre pays, suivant un ton similaire à leurs œuvres précédentes : Propaganda (2014) et Dios (2019).

Après être passé par des festivals tels que la Berlinale et SANFIC -et avoir été récompensé à Biarritz comme meilleur documentaire…
Une crise sociale sans précédent éclate au Chili. Une partie de la société s’organise contre un système inégalitaire en rédigeant une nouvelle constitution, tandis qu’une autre partie boycotte silencieusement le processus. Oasis est un film collectif qui suit le processus constitutif historique le plus important de l’histoire du Chili, en observant les cicatrices entre la société et la nature.
Parlez-moi de la genèse de ce projet, créé avec le collectif MAFI, qui réunit de nombreux cinéastes. Comment s’est déroulé le processus ? Comment le projet a-t-il vu le jour ?
Le projet est né de manière très organique, le 18 octobre, quand en pleine révolte sociale, plusieurs personnes du collectif et quelques autres personnes qui connaissaient le collectif mais qui n’en faisaient pas partie, ont décidé d’aller manifester avec leurs caméras et de filmer des plans fixe dans un registre documentaire, c’est le format dans lequel le collectif MAFI travaillait depuis pas mal de temps, depuis sa création en 2012. Pendant la révolte, ces images ont été réalisées et les auteurs ont envoyé ces plans qui filmaient la révolte au contact du collectif, aussi comme un espace où beaucoup d’images étaient générées, comme une révolte avec une caméra à la main. Les collectifs de cinéma, et pas seulement le MAFI, étaient un lieu où ces images pouvaient être diffusées. Nous avons donc reçu beaucoup de matériel à cette époque, nous avons aussi beaucoup filmé, sans trop savoir ce que nous faisions. L’idée était de générer des images dans un moment qui était le centre de toute l’attention, et c’est plus tard, lorsque la possibilité d’écrire une nouvelle constitution s’est mis en place, d’ouvrir un processus constituant, que, en tant que collectif, nous avons pensé à faire un film. C’est à ce moment charnière où nous nous sommes dit : « C’est une question sans précédent, qui va attirer l’attention du pays pendant longtemps », qu’il nous est venu à l’esprit de faire un film, et à partir de là, nous avons commencé à travailler de manière plus formelle à l’idée d’un long métrage.
Comment s’est déroulé le processus de réalisation du film, compte tenu du grand nombre de cinéastes impliqués dans le collectif et de votre rôle en tant que leader ?
Lorsque l’idée du film est apparue, tous les membres du collectif ont dit : allons-y. À partir de nos positions personnelles, chacun a dit comment il aimerait participer à ce film. C’est là que les producteurs sont apparus, des producteurs exécutifs, des producteurs généraux, et les réalisateurs sont entrés en jeu. Ensuite, nous nous sommes demandés : « Qui veut faire ce film ? Moi, et je veux le faire à partir d’ici. Eh bien, allons-y. » Nous avons pris ces positions hégémoniques dans le cinéma, comme la réalisation, la production. Même si c’est une direction très peu conventionnelle, dans le sens où ce que nous avons fait était comme une direction générale, qui est en fait comme une tête qui pense tout le temps au projet, et qui est chargé de coordonner le réalisateur, de systématiser la recherche qui est faite dans la production, et de diriger toute cette partie, mais toujours en tant que groupe, toujours ensembles. En ce sens, le travail que nous avons réalisé, moi, Tamara, Alba, Diego, Catalina Alarcón, Royeler García, qui étaient les producteurs généraux, cela toujours été un travail de groupe, où nous avons avancés ensemble. La réalisation collective est également un domaine dans lequel MAFI possède une grande expérience. Leurs précédents projets de longs métrages, Propaganda et Dios, ont également été réalisés collectivement, avec une direction générale et une méthodologie assez simple.
Le collectif, en général, tous les réalisateurs qui l’intègrent savent que ce film est en cours de tournage et nous sommes en contact permanent en cas de tournage, par exemple, d’une manifestation dans le sud du Chili. Nous appelons, par exemple, les cinéastes qui se trouvent dans le sud, comme Israel Pimentel, qui vit à Frutillar, et nous lui disons : « Que penses-tu d’aller filmer tel jour pour tel manifestation ? Oui, je peux ». Nous faisons une réunion, où nous faisons le point sur ce qui est en cours de tournage, sur le plan que nous recherchons, et puis le tournage a lieu. Ce réalisateur y va, avec l’objectif de filmer un plan que nous supposons qui va se passer et qui contient ce que nous recherchons, mais quand il s’agit de filmer, ce réalisateur dirige son tournage. Il a donc la liberté absolue de donner son point de vue, disons, dans les situations qu’il filme et de générer des images qui ne sont pas nécessairement les nôtres. Si cela coïncide, tant mieux, mais si ce n’est pas le cas, de nouvelles choses apparaissent également et changent parfois le cours du film. C’est ainsi qu’un film s’écrit au fur et à mesure qu’il est tourné. Et ainsi de suite avec tous les autres réalisateurs.

Comment avez-vous géré le récit, et quels étaient les points que vous aviez définis au départ ? Le processus constitutif, l’intrigue, le fil conducteur, les avez-vous définis dès le départ ou ont-ils émergé au fur et à mesure que vous rassembliez le matériel ?
Il a émergé, mais nous avons quand-même écrit un scénario documentaire, c’est-à-dire une feuille de route qui nous a servi de perspective collective, de ce que nous voulions filmer ou de ce que nous pensions qu’il allait se passer et de la manière dont nous voulions le faire. Lorsque, par exemple, l’idée de faire le film est apparue, une commission de scénario a été mise en place, très proche d’une assemblée narrative. Cette commission a travaillé sur un scénario, en réfléchissant à ce qui pouvait se passer dans ce processus et en définissant la structure qui allait fonctionner comme la feuille de route que je mentionnait.
À l’époque, certaines choses qui ont été projetées se sont produites, à savoir les conflits au sein de l’hémicycle constitutionnelle, la confrontation entre la gauche et la droite, et des personnages clés qui allaient émerger. Cela fonctionnait donc comme une feuille de route qui correspondait à une logique plus documentaire, plus observationnelle, plus exploratoire, au lieu de tout changer dans l’instant. Dans ce sens, au fur et à mesure que nous filmions, certaines choses sont apparues qui ont attiré notre attention. Par exemple, la Commission sur l’environnement et tout ce qui avait trait à la discussion sur l’eau, qui était une thématique également issue de la révolte, comme les luttes environnementales menée par les organisations sociales, ont pris un fort protagonisme. Nous avons pensé que la réflexion sur cette question particulière pourrait soulever de nombreuses autres questions en général : le droit à la propriété, l’utilisation des terres, le conflit de classe à partir de cet endroit, qui était également très visuel, comme la crise climatique, la sécheresse au Chili.
Nous avons estimé qu’il pouvait s’agir de quelque chose de structurel dans le cadre de ce qui pouvait être filmé à la convention et en dehors de la convention, ce que le film a fait en grande partie. Dans ce processus, nous prenions des décisions au fur et à mesure qu’elles étaient filmées sur cette feuille de route, avec laquelle on pouvait rompre à tout moment. C’est ainsi que nous avons travaillé tout au long du processus, jusqu’au moment de l’assemblage de la matière et du montage du film, où les récits et les structures ont commencé à apparaître, avec les matériaux sur la table, avec les cartes disposées, qui sont les plans, les images. Toujours dans cette logique mi-assemblée, où nous avons discuté, parfois houleusement, nous avons fait des visionnages collectifs, nous en avons fait beaucoup et avec beaucoup de gens, nous avons reçu des commentaires, ce fût un processus presque comme l’élaboration d’une Constitution, comme si l’élaboration du film l’accompagnait. C’est ainsi que cette structure narrative a été construite.
Quels sont les éléments qui, selon vous, diffèrent des autres documentaires réalisés pendant cette période ? De nombreux cinéastes sont allés filmer pendant la révolte, et plusieurs documentaires sont déjà sortis cette année, comme El que baila pasa, et d’autres encore.
Tous ces films sont très différents, très diversifiés. El que baila pasa est un film d’archives, comme cette soif que Carlos Araya a, pour rassembler des archives et sentir que dans ces matériaux qui peuvent être perdus et qui ont été perdus, quelque chose peut être fait. Les autres ont également adopté des points de vue différents. Je pense que tous les films indépendants qui tentent de traiter le même processus, la même situation, se différencient par leur point de vue. Nous parlons ici du film Oasis, qui est un film collectif construit à partir de différents points de vue, mais qui a aussi une esthétique différente, ce qui en fait un regard particulier sur un moment où il y avait beaucoup de gens et beaucoup de caméras qui regardaient, et pas seulement des cinéastes. Je pense que nous avons toujours été inspirés par l’idée qu’il existe des lieux communs, mais pas de regards. Nous avons pensé que cela méritait aussi un processus de tournage. Des films sur la révolte, il n’y en a pas tant que ça. Il y en a plein qui sont encore en cours de réalisation et d’élaboration. Nous travaillons actuellement à un film sur les mères d’octobre, qui est le titre du film et que je trouve particulièrement émouvant. Ce sont des moments où tant de choses se sont passées pendant si longtemps, tant d’histoires et de mémoire à générer par rapport à tous ces processus, à la fois la révolte et le processus de Constitution, qui s’applique également comme une sorte de tendance à l’oubli, de le faire passer comme un événement traumatisant pour la société… les films sont super nécessaires et seront toujours différents, précisément parce qu’ils sont faites par des personnes différentes.
Donc, ce qu’Oasis a, c’est qu’il réunit tous ces gens qui étaient très intéressés par le tournage de ce film. Si je devais choisir une différence un peu plus technique, je pense qu’elle est liée à l’accès que nous avons eu à l’hémicycle où se déroulait la convention, où nous avons pu passer beaucoup de temps à l’intérieur, à observer, à écouter et à apprendre à connaître les tenants et les aboutissants de ce processus. Cela s’est avéré très intéressant et a été très bien accueilli par les spectateurs qui ont pu voir le film jusqu’à présent.

Le film explique au début qu’il est réalisé en plans fixes, alors qu’à l’époque il n’y avait pas beaucoup de plans, de mouvements, de gens qui couraient. Ici, le plan fixe, qui est super observateur, qui est long, où l’on peut observer ce qui se passe, et du fait de la durée à laquelle chaque plan est destiné, on peut observer des gestes, des regards, des détails… Comment en êtes-vous venu à cette proposition ?
Le plan fixe remonte aux débuts du cinéma, mais il a quelque chose de très intéressant qui permet, d’une part, de faire appel à la patience, à l’attente, parfois même à l’ennui d’une image. Dans ce film, où chaque plan est une scène, il y a un temps long, très long, qui vous permet de parcourir les images et d’être avec vous-même, en train de regarder un film, un film qui vous explique tout le temps ce qui se passe et, dans ce sens, il y avait beaucoup de ferveur, où tout se passait très vite, prendre de la distance et attendre, observer lentement, c’était presque un acte absurde. Mais dans cette absurdité, il y a des choses très nourrissantes qui génèrent des réflexions. Nous n’avons pas eu l’angoisse de finir le film très vite, parce que nous savions que cela allait prendre beaucoup de temps et que cela allait être lent, surtout la phase de montage, mais il n’y a pas eu d’urgence, ni pression créative ni artistique, qui nous ait dit : il faut faire ce film rapidement. Nous avons dû attendre que les choses se passent et lorsque nous avons été satisfaits, nous avons mis nos efforts à contribution et nous l’avons fait. Donc, le plan fixe, au-delà de la tradition du collectif de filmer ainsi, parce que les films de MAFI sont comme ça, comme Propaganda et Dios, MAFI a plus de films qui sont très différents, mais il y avait un certain sens de la prise de distance dans un moment qui semblait si proche et de ralentir quand il semblait si rapide, d’aller à contre-courant de ce qui se passait, précisément pour que les réflexions qui en sortent soient nouvelles.
Au sujet du processus de montage. Le fait que la première du film ait lieu à l’occasion de l’anniversaire des cinq ans de la révolte sociale était-il une sorte d’objectif ? Cinq ans après a-t-il une signification symbolique ?
Il l’a comme conséquence, mais ce n’était pas l’objectif. Si le film observe la révolte sociale et le premier processus constituant jusqu’à la victoire du rejet, il n’est pas un spoiler, tout le monde le sait. En fait, le film n’observe pas le deuxième processus constituant mené par l’ultra-droite, mais reste dans le premier. Lorsque cela s’est terminé dans l’histoire du Chili, nous avons immédiatement commencé à monter, à faire un processus de montage qui commence par le visionnage de tout le matériel. Entre-temps, certaines choses ont été filmées, mais il ne s’agissait pas d’une stratégie, comme la sortie du film à telle date. Ce que nous savions, c’est qu’en termes de distribution, le film allait vieillir, ce qui aurait peut-être été plus préjudiciable à sa distribution, car moins de gens l’auraient vu au Chili et à l’étranger, il aurait perdu une certaine validité, mais c’est aussi quelque chose que nous n’avons pas fait si rapidement. Je pense que le processus de montage a été lent parce qu’il est lent de voir des images tout le temps ; on ne peut pas se précipiter pour voir un matériel. Il est ce qu’il est. Mais il fallait une certaine inertie qui ne devait pas s’arrêter parce que ça avait déjà été un processus tellement fatigant, filmer dans la révolte, tellement fatigant et fastidieux, filmer à la Convention, quitter la Convention, filmer dans les territoires, c’est aussi un travail très long qui implique beaucoup d’énergie, et les financements sont si rares. Prendre beaucoup de temps pour le faire, c’est aussi un gaspillage de toute cette énergie et de ces budgets. Ce qui nous a accélérés, vers la fin et qui a conduit à cette première, à l’occasion de l’anniversaire des cinq ans de la révolte, c’est que nous nous sommes retrouvés à un moment avec un premier montage dont nous avons dit : « Voilà un film qui peut être travaillé », qui a ensuite beaucoup changé, des choses ont été filmées pour le montage, des choses qui nous manquaient, d’autres petites choses ont été réenregistrées. Puis nous nous sommes dit : « Nous allons terminer ce film à telle date, il sortira ici et il coïncidera avec les cinq ans de la révolte, eh bien, allons-y ».
Quel a été le plus grand défi dans tout ce processus pour vous, pour le collectif ?
Parvenir à un accord. C’est très difficile, très difficile parce que nous avons tous des positions politiques différentes. Bien qu’il n’y ait pas de personne de droite, nécessairement, dans le collectif. Regarder un processus qui nous concernait, la révolte de très près, le processus constituant avec ceux qui étaient super impliqués et avec beaucoup d’espoir, c’était quelque chose qui, contrairement aux autres films, était très impliqué dans nos positions politiques et nos positions personnelles. Le moment est donc venu d’en parler et de savoir quoi défendre, où résister, où céder. Tout cela en pensant qu’il ne s’agit pas d’un film reflétant le point de vue d’un ou deux réalisateurs seulement ; il y en a plusieurs, et il fallait donc que ce soit quelque chose d’uni. C’était un véritable défi, parce qu’il n’y a pas de forme, pas de méthodologie pour cela. Il s’agit simplement de parler, d’écouter et d’essayer de se faire bien comprendre. C’était donc très difficile, très intéressant et aussi très enrichissant à la fin. C’est comme s’il y avait un juste milieu : ces discussions, dans le bon sens du terme, n’ont pas nécessairement été résolues d’une manière idéologique, mais elles ont été exprimées dans le matériel et le film les promeut et les partage, ce qui est fondamental. Indépendamment des positions politiques de chacun, l’idée de poursuivre la conversation. C’est ce que j’apprécie le plus, d’être un film collectif, et c’est ce que j’apprécie aussi beaucoup dans ce film.

Que vous est-il arrivé, à vous et aux autres, lorsque vous avez réalisé, à l’issue de ce processus, que le processus constitutif s’était finalement terminé comme il l’avait fait ? Que vous est-il passé par la tête au moment de réaliser ce processus ?
Ce fut un peu une surprise. Malgré le fait que, lorsque nous étions à l’intérieur, bien que nous ayons cru, comme tout le monde, que l’approbation du projet constitutionnel allait gagner, il y avait toujours un sentiment de « regardez, faites attention à cela », comme si cela pouvait ne pas être le cas. Je dis cela à titre personnel et en écho à certaines conversations que j’ai eues avec des personnes qui ont vu le film, comme si les techniques de la droite et leur façon machiavélique de boycotter le processus lui-même pour leurs propres intérêts avaient été grandement sous-estimées. Cette question, que lorsqu’un plébiscite est organisé avec un vote obligatoire et que l’idée de tout changer l’emporte avec 80 %, 78 %, et qu’un corps constituant est élu avec des gens que vous avez vus dans les manifs. Je viens de Quilpué et il y avait une collègue de Belloto Sur qui était une des rédactrice du projet Constitutionnel et qui me donnait une certaine assurance que les choses allaient déboucher d’une manière ou d’une autre vers quelque chose. Mais nous n’avons jamais acheté cette certitude non plus, nous avons toujours regardé avec la méfiance nécessaire, qui, je pense, est toujours nécessaire pour un documentaire. Ne jamais glorifier certains personnages, ne pas faire de blagues pour le plaisir de faire des blagues, toujours chercher un contraste avec ce que l’on observe, ne pas faire des plans colorés ou des plans très étouffés. Alors quand le rejet du projet Constitutionnel l’emporte, je me souviens parfaitement de ce jour-là, parce qu’on tournait à Valparaíso. J’étais là, et il y avait Paul Petit Laurent, qui est l’ingénieur du son, il vient de Purén, mais vit à Valparaíso. Nous sommes partis tous les deux en voiture pour faire le tour de Valparaiso et voir ce qui s’y passait. En outre, ce jour-là, c’était mon anniversaire, le 4 septembre ; il y avait une certaine joie dans le travail, nous roulions, nous parlions, nous écoutions la radio. Je me souviens que nous sommes allés à Ventana, pensant peut-être assister à une fête quelque part où des images du film avaient été tournés, ces environnements autour des grandes centrales thermoélectriques comme Ventana. La journée a été incroyablement calme. Lorsque nous avons appris le résultat du plébiscite, nous étions garés sur la Plaza Sotomayor et il ne se passait rien, c’était très calme. Je pense que c’était aussi l’impact du résultat que nous pouvions voir venir, mais personne ne pensait que ce serait comme ça. « Et on s’attendait à quoi ? » Personnellement, je ne suis pas un grand fan des grandes fêtes démocratiques ; je les ai toujours trouvés un peu trompeurs. On en a vu tellement passer. Nous avons réussi à tourner le film et nous avons eu accès à de grands moments où la droite construisait sa campagne et avons vu comment cela avait un impact sur les gens, sur les gens ordinaires. Faire un texte Constitutionnel si ambitieux en termes de progrès, mais qui avait aussi un certain caractère néolibéral, en raison des caractéristiques du pays. Le Chili est un pays profondément néolibéral. Mais l’ambition, c’était de vouloir battre le capitalisme autour d’une table, en discutant dans la bonne humeur. C’était donc un peu comme une goutte d’eau dans l’océan, c’était « bon ». C’était intéressant parce que c’était comme si une autre oasis avait été construite, comme s’il y avait une oasis qui était cette vision de Piñera, super-entrepreneur, et que le Chili allait bien et tout le reste. Puis une autre oasis a été construite, qui est écrite et qui est également détruite, et à la fin, c’est comme un mirage, rien de très réel.
Que pourriez-vous dire aux gens pour les encourager à aller voir le film ?
Qu’ils osent aller voir le film, qu’il est très intéressant d’en parler après le film, non seulement dans les discussions qui auront lieu lors des projections d’Oasis, mais aussi comme un film dont on peut reparler. Comme ce grand geste social qui est apparu si magnifiquement pendant la révolte, de se réunir organiquement sur les places, de s’organiser en assemblées, de l’apparition des conseils territoriaux. Je pense que le film fait référence à cet esprit, pour parler à nouveau, pour nous interroger à nouveau sur ce processus, pour élever nos voix de l’intérieur et verbaliser ce que nous ressentons, ce que nous ressentons maintenant, comment nous voyons les choses, ce qui change. Je pense que c’est très bon pour toute société, quel que soit son caractère, pour tout groupe de personnes. C’est un film dont il est bon de parler entre voisins, en famille, parce que nous avons tous vécu ce moment.
Si nous voulons le jeter dans le bac de recyclage et le vider, nous en subirons les conséquences. Le Chili est un pays qui sait oublier, mais c’est pour cette raison qu’il est bon de trébucher plusieurs fois. Il est donc bon de ne pas oublier, de se souvenir et d’en faire un exercice. En ce sens, je trouve que tous les films qui sont faits et qui considèrent et travaillent autour de cette mémoire sont toujours bons à voir, plus d’une fois. En ce sens, il y a beaucoup de fierté, du moins de ma part, pour tous les cinéastes qui documentent des processus comme celui-ci, mais aussi l’autre, et qui continuent à le faire et à avancer dans leurs projets, parce que le sentiment de défaite est très grand, à la fois pour la révolte et pour le processus constituant, et il est très facile d’en sortir déprimé. Il est bon de redécouvrir ces choses qui nous rendent fiers dans les deux processus, et elles feront de nous des personnes plus sensibles, plus intelligentes lorsqu’il s’agit de parler. Parce que parler est un exercice d’intelligence, s’ouvrir à une autre personne, écouter et parler est un processus de croissance. Il est bon d’entendre cela, qu’il existe un processus d’apprentissage, une mémoire, et que les processus politiques, quelle que soit la manière dont ils se déroulent, doivent toujours être mémorisés ; sinon, les mêmes erreurs sont commises encore et encore.
Par Galia Bogolasky / culturizarte / 30 octobre 2024 / traduit par Kinolatino