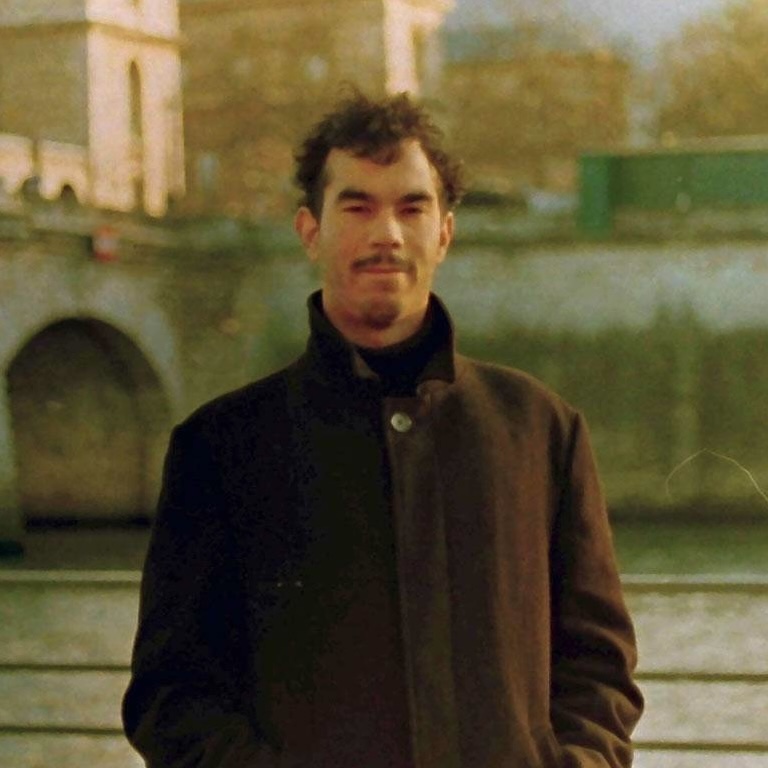César Díaz confronte son histoire dans Mexico 86
Savina Petkova

Le réalisateur belgo-guatémaltèque César Díaz aborde l’ambivalence de l’histoire et les influences personnelles qui nourrissent son deuxième long métrage, Mexico 86.
Le protagoniste du premier film de César Díaz, NUESTRAS MADRES (2019), était un archéologue médico-légal qui tentait de découvrir la vérité sur son père – disparu pendant la guerre civile guatémaltèque, dans les années 1980. Aujourd’hui, avec Mexico 86, le réalisateur d’origine guatémaltèque revient sur cette même période historique dans sa patrie déchirée par la guerre. Dans ce deuxième film, Maria (Bérénice Béjo), résistante de gauche et nouvellement mère, prend la difficile décision d’abandonner son fils Marco (Matheo Labbé) lorsqu’elle s’enfuit au Mexique. Dix ans plus tard, le garçon, qui espère un avenir meilleur, veut revoir sa mère. Accompagné de sa grand-mère et aidé d’un faux passeport, il la retrouve en exil au Mexique, où elle a poursuivi sa lutte pour la justice et l’activisme révolutionnaire, dans la clandestinité.
Dans l’œuvre émotionnelle de Díaz, les mères et les pères sont plus que de simples personnifications du Guatemala en tant que patrie troublée. En effet, les relations parents-enfants qui ont encadré ses récits jusqu’à présent incarnent la lutte pour négocier son propre passé et son propre présent, où se croisent le personnel, le politique et le social. À première vue, Mexico 86 est un drame policier d’époque au rythme rapide, avec des enjeux narratifs importants : Maria parviendra-t-elle à maintenir sa présence clandestine au Mexique ? Parviendra-t-elle à nouer avec Marco le lien parent-enfant absent depuis une décennie ? Mais parler avec Díaz révèle les nuances les plus subtiles du film : la profondeur de l’attention qu’il porte à ses personnages, son ambivalence quant à sa propre relation au passé. Au cours de notre conversation, le cinéaste s’est penché sur l’histoire personnelle de Mexico 86.

Savina Petkova : Après avoir vu vos deux films l’un après l’autre, j’ai eu le sentiment inexplicable que Mexico 86 avait existé, sous une forme ou une autre, avant Nuestras Madres, votre premier film. Est-ce le cas ?
César Díaz : En fait, oui ! Nuestras Madres a commencé comme mon projet de fin d’études à l’école de cinéma, en 2012. Comme vous pouvez l’imaginer, il a fallu du temps pour le développer et le financer. Finalement, nous avons obtenu un peu d’argent belge, mais cela a quand même pris du temps. Entre-temps, j’avais commencé à écrire un film intitulé Call Me Mary : l’histoire d’une immigrée guatémaltèque à Bruxelles qui a laissé son fils derrière elle et qui, dix ans plus tard, revient en Belgique pour la retrouver. Pour moi, cela a toujours été le cœur de Mexico 86 : deux personnes qui sont étrangères, même si elles sont mère et fils, et qui doivent apprendre à vivre ensemble. Mais à ce moment-là, tous les commentaires que je recevais sur ce scénario le décrivaient comme une histoire d’immigration, et je ne voulais pas en faire une histoire d’immigration. Mais lorsque l’un de mes producteurs m’a demandé d’expliquer l’origine de l’histoire de Call Me Mary, je lui ai raconté comment ma mère avait quitté le Guatemala pour le Mexique et comment j’avais grandi avec ma grand-mère à la place. Il m’a dit : « Pourquoi n’écrivez-vous pas cette histoire ? ».
SP : Il semble que c’était une invitation à rendre l’histoire personnelle. Comment abordez-vous cet aspect personnel de la réalisation d’un film ?
CD : Le fait est que j’ai besoin d’un sujet, d’un événement ou d’un personnage qui me tienne vraiment à cœur. Lorsque j’enseigne, je conseille toujours à mes élèves de choisir un sujet qui leur tient à cœur, car ils devront vivre avec pendant cinq ou dix ans, voire plus. Et si vous ne l’aimez pas vraiment, vous le laisserez tomber ! Pour moi, en fait, c’est un moyen de mieux connaître les personnages – je dois connaître ces personnes et savoir ce qu’elles ressentent dans certaines situations. Je suppose que c’est ainsi que mon expérience personnelle m’a aidé à développer mes films. J’ai aussi la chance d’avoir une identité mixte, guatémaltèque, mexicaine et belge, ce qui m’a permis de réaliser plus facilement [financièrement] le genre de films que je veux faire [grâce aux coproductions et au financement de l’UE]. Nous vivons à une époque où le nationalisme se développe et où les nationalités s’éloignent les unes des autres, mais il faut comprendre que le cinéma est le langage universel.
SP : Ce qui m’a frappé dans le film, c’est que Maria et Marco ne sont pas vraiment mère et fils, en ce sens qu’ils ne se considèrent pas comme tels : elle est une combattante en quête de vérité et lui est un garçon de 10 ans. Étant donné qu’ils ne sont pas liés par leur relation familiale, comment avez-vous construit un récit dans lequel ils se rapprochent puis s’éloignent à plusieurs reprises ?
CD : Le principal défi, d’un point de vue narratif, était d’éviter que le garçon ne devienne un fardeau. S’il le devenait, elle aurait abandonné. Pourtant, je savais qu’au fond d’eux-mêmes, ils devaient tous deux partager ce sentiment déroutant d’appartenir l’un à l’autre, sans savoir pourquoi ni comment. En termes de narration, je crois que cette histoire est un passage à l’âge adulte pour Marco, mais bien sûr, pour Maria, c’est différent. Son voyage narratif est guidé par un seul objectif [l’action révolutionnaire] et se heurte à de nombreux obstacles, dont Marco fait également partie. C’est pourquoi son passage à l’âge adulte me semble si poignant : il en vient à comprendre les raisons pour lesquelles sa mère l’a quitté. Faire un choix non pas parce qu’on n’aime pas quelqu’un, mais parce qu’on sait que cette personne n’a pas d’espace pour nous dans sa vie, c’est magnifique.

SP : Et c’est valorisant ! Souvent, et plus souvent encore dans les films d’époque, les enfants peuvent être considérés comme un handicap ou comme un sentiment abstrait – « les enfants sont l’avenir » – mais Mexico 86 va à contre-courant. Comment avez-vous façonné le personnage de Marco, un jeune garçon singulier et pourtant racontable ?
CD : Au début, tous ceux qui ont lu le scénario ont commenté le fait que nous ne suivions pas le point de vue de Marco. Je pense que dans l’imaginaire collectif, nous pouvons facilement nous identifier à ce genre de personnages d’enfants – si nous pensons aux 400 Coups (Les Quatre Cents Coups, 1959), ou au film argentin Infancia Clandestina (Enfance Clandestine) de 2011, nous sommes déjà habitués à cela en tant que spectateurs. Mais pour Mexico 86, je savais que cela ne fonctionnerait pas nécessairement, parce que le public finirait par juger Maria, elle aurait l’air d’une « mauvaise mère », peu importe ce que cela signifie, et occulterait les complexités de sa cause et de son sacrifice. Mais lorsque vous suivez son point de vue, vous comprenez les enjeux, leur importance, et à quel point elle croit fermement à la transformation de la société.
SP : Le film est dédié à votre mère. Le personnage de Maria a-t-il été inspiré par l’activisme de votre propre mère pendant la guerre civile guatémaltèque, ou par les conversations que vous avez eues avec elle ?
CD : Oui, je demandais toujours à ma mère et à ses compagnons : « Pourquoi ? » C’est un combat tellement difficile et douloureux, surtout dans le contexte de votre propre famille, vous devez constamment prendre des décisions difficiles. Mais elles me répondaient : « Parce que nous voulions créer un monde différent pour toi et ta génération ». Je pense qu’il y a là quelque chose de noble, parce qu’on ne pense pas à soi et qu’on est conscient qu’une transformation sociale et politique prend du temps. Vous ne vivrez peut-être pas assez longtemps pour la voir, mais vous pouvez encore offrir quelque chose de meilleur à ceux qui vous succéderont. Nous avons besoin de personnes comme Maria pour changer le monde. Si nous restons assis tranquillement et que nous allons manifester de temps en temps, cela n’arrivera pas.
SP : En ce qui concerne le casting, est-ce que ces considérations ont joué un rôle dans le choix de Bérénice Béjo pour le rôle de Maria et de Matheo Labbé pour celui de Marco ?
CD : J’ai toujours aimé le travail de Bérénice, mais au début je cherchais une actrice guatémaltèque. Aucune de celles que nous avons auditionnées n’était capable d’atteindre l’intensité dont nous avions besoin et de porter le personnage de Maria sur ses épaules – et puis j’ai vu un film argentin où Bérénice Béjo parlait espagnol et pour la première fois j’ai réalisé qu’elle était originaire de ce pays. Elle était partie pour échapper à la dictature. À ce moment-là, je pense que j’ai commencé à façonner le personnage en pensant à elle, mais je n’étais pas sûre que l’idée puisse aller quelque part. Parler aux producteurs était effrayant parce qu’elle est nominée aux Oscars, mais ils m’ont soutenu et voulaient au moins essayer.
SP : Je suppose que vous l’avez rencontrée en personne et que vous avez peut-être sympathisé sur des histoires personnelles de déplacement ?
CD : Oui ! Nous nous sommes rencontrés à Paris, après qu’elle ait lu le scénario. Nous avons eu une forte connexion et nous n’avons pas du tout parlé du film ! Nous avons parlé de nos expériences pendant des heures et, à la fin, j’ai dit quelque chose comme : « Mais tu veux vraiment faire ce film ? “, ce à quoi elle a répondu : ” Bien sûr ! C’était un rêve devenu réalité.
SP : Et Matheo ? C’était son premier rôle.
CD : Oui, et le casting pour Marco a pris beaucoup de temps. Au début, nous organisions des auditions pour les enfants, sans scénario ni texte, en rencontrant simplement les enfants et en discutant avec eux, puis en leur présentant des situations et en voyant comment ils réagissaient. Nous examinions également leur langage corporel, leur capacité de concentration et ce qui leur convenait. La particularité de Matheo – et j’ai trouvé cela assez déterminant – c’est qu’il est diabétique depuis son plus jeune âge. C’est encore un enfant, mais en même temps, en raison de ses problèmes de santé, il a une certaine maturité. Pour le personnage de Marco, nous avions besoin de quelqu’un qui puisse grandir très vite dans sa vraie vie, Matheo a également dû grandir rapidement. Mais en ce qui concerne le travail sur le plateau, nous avons discuté avec ses parents qu’il serait préférable de ne pas lui donner le scénario complet, donc nous avons travaillé scène par scène : chaque jour, il recevait la scène du lendemain et petit à petit, il a découvert le film dans toute sa plénitude.

SP : Vous avez tourné au Guatemala et au Mexique. En quoi ces deux expériences ont-elles été différentes pour vous, sur le plan industriel et personnel ?
CD : Tourner au Guatemala, c’était comme être à la maison, parce que nous avions la même équipe que pour Nuestras madres. Nous étions les mêmes, mais c’était un peu différent parce que nous nous connaissions mieux et que nous pouvions aller plus loin dans certaines scènes, ou travailler plus vite, ce qui était formidable. Par exemple, la directrice de la photographie [Virginie Surdej] et moi n’avions même pas besoin de nous parler parce que nous avions déjà travaillé ensemble à maintes reprises ; nous partageons les mêmes références. Mais cette fois-ci, ce qui était magnifique, c’est que nous étions là, ensemble, à marcher dans les rues, et que j’ai pu lui montrer les endroits où tout ce qui était dans le scénario s’était passé, y compris les massacres. À ce moment-là, les choses sont devenues très réelles pour nous deux. Partager cette expérience était très spécial pour tout le monde.
SP : Le Mexique, c’était une autre histoire, n’est-ce pas ?
CD : Comme vous le savez, le Mexique possède une énorme industrie cinématographique. Un jour, nous sommes 50 personnes sur le plateau au Guatemala, et le lendemain, nous sommes 125 au Mexique. Honnêtement, cela a été un choc pour moi de voir tous ces gens courir partout… C’est une autre façon de travailler. Je ne juge pas ! Je dis simplement qu’il est difficile de passer d’une petite équipe familiale à plus de 100 personnes en une journée. Il y avait beaucoup de « oui monsieur, non monsieur » et je disais toujours « je m’appelle César, d’accord ? On arrête les conneries. » [J’ai certainement eu besoin d’un temps d’adaptation. Mais je dois dire que j’ai appris à tourner des scènes d’action, ce que je n’avais jamais fait auparavant. Heureusement, mon premier assistant réalisateur [Pierre Abadie] avait fait beaucoup de scènes d’action et savait comment s’y prendre. C’était comme avoir un coach en action [rires] et j’ai vraiment apprécié cet énorme processus d’apprentissage.
SP : L’histoire de Mexico 86 commence en 1976, au Guatemala, ce qui correspond également à la période dont parle Nuestras madres, même si le film se déroule à l’époque actuelle. En d’autres termes, ce qui apparaît comme un passé traumatique qui se répercute tout au long de votre premier film devient le présent dans le nouveau film.
CD : C’était la période la plus sombre de l’histoire récente du Guatemala, donc c’était très difficile. Mais honnêtement, c’est aussi une obsession et une peur pour moi. J’ai vraiment eu peur pendant toute cette période. Je me souviens des violences, de la police et du fait que le dictateur apparaissait si souvent à la télévision qu’on avait l’impression qu’il était un proche. Je me souviens également d’avoir quitté le pays. Pour moi, le retour était donc une façon d’affronter cette histoire. Cependant, aussi sombre et difficile que cela ait été, il y a une forme d’espoir. Car la génération de mes parents, comme je l’ai dit, croyait vraiment qu’elle pouvait changer l’histoire et transformer sa société.

SP : Qu’avez-vous ressenti en retournant dans le pays où vous avez grandi ?
CD : J’ai vraiment eu l’impression de me replonger dans mes souvenirs. J’ai grandi au Mexique et le fait d’être sur place m’a certainement aidé à me rappeler comment c’était, à l’époque. Mais n’oubliez pas que la version de Mexico dont je me souviens dans les années 80 n’existe plus. À l’époque, c’était aussi une ville incroyable, mais elle était encore… je ne sais pas comment l’expliquer, elle était humaine – ou du moins mieux à même de relier les humains les uns aux autres. Par exemple, lorsque j’allais à l’école à l’âge de 10 ans, j’ai traversé toute la ville, du nord au sud, par les transports publics. Cela me prenait 45 minutes et il ne m’arrivait jamais rien de grave. Mais aujourd’hui, personne ne permet à un enfant de 10 ans de faire cela, et le trajet dure deux heures et demie. Mexico est devenue une ville gigantesque qui échappe au contrôle, ou du moins au contrôle des citoyens…
SP : Et si vous reveniez à cette période particulière ?
CD : Pour être honnête, je pense que c’est la dernière fois que je retourne là-bas, à cette époque. Il a été très important pour moi de le faire parce que je crois que c’est une façon fructueuse de confronter les Latino-Américains d’aujourd’hui, à travers notre propre histoire récente. Les films d’époque réalisés aujourd’hui disent : « Vous savez quoi ? Nous étions là il y a 40 ou 50 ans. Nous ne devrions plus y être ! » La semaine dernière, j’ai vu des images d’arrestations en Argentine qui m’ont rappelé un passé pas si lointain. Cette image aurait pu être prise dans les années 80 et elle aurait été la même. C’est terrifiant, mais nous devons nous souvenir. La raison pour laquelle nous faisons des films est de rappeler aux gens que cela peut se reproduire. Nous ne pouvons pas permettre que cela se reproduise parce que nous avons tiré les leçons du passé – du moins je l’espère.
Par Savina Petkova / Festival Locarno
Traduit par Kinolatino