
Entretien avec Juanjo Pereira, réalisateur de « Bajo las banderas, el sol »
Mariale Bernedo

Le documentaire Bajo las banderas, el sol (2025), est le premier long métrage du cinéaste et chercheur paraguayen Juanjo Pereira. La plus longue dictature militaire du continent a eu lieu au Paraguay, dirigée par le général Alfredo Stroessner, qui a conservé le pouvoir pendant 35 ans.
Grâce à un montage précis et percutant, la compilation d’archives trouvées dans différents pays permet non seulement de comprendre, mais aussi de ressentir la douleur causée par la dureté de l’oppression du Parti Colorado, qui a accueilli l’« ange de la mort » d’Auschwitz, le nazi Josef Mengele (médecin personnel du dictateur), tandis que les tortures et les disparitions forcées faisaient des victimes parmi la population opposée à Stroessner. Nous avons discuté avec le réalisateur de son film, du concept d’archives dans un contexte de désintérêt pour leur préservation, et des moyens de créer un documentaire politique qui transmette avec acuité la douleur passée sous silence.
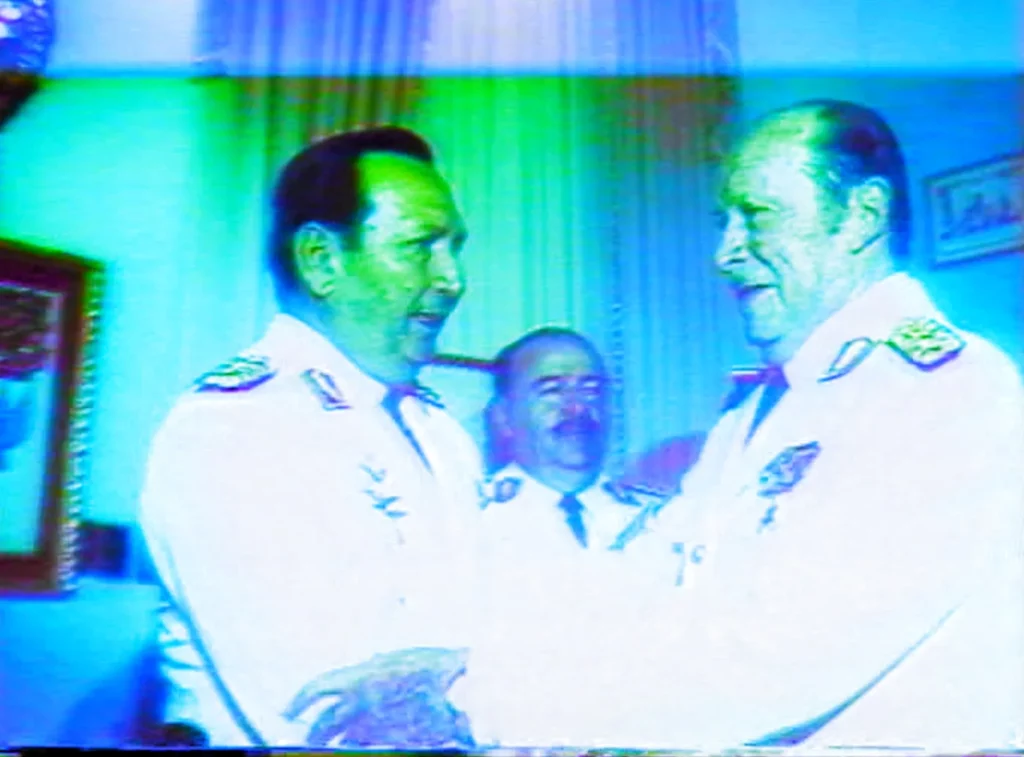
Mariale Bernedo : Juanjo, nous voyons qu’en plus d’être cinéaste, vous faites des recherches dans les archives cinématographiques. Avez-vous toujours été intéressé par les archives liées à la dictature de Stroessner ? Aviez-vous déjà pensé à en faire un film ?
Juanjo Pereira : En fait, je n’y ai pas pensé comme à un film. Quand j’étais petit, je collectionnais des choses et j’aimais beaucoup avoir des fiches. J’aime beaucoup les données, les statistiques, et je suis très curieux dans ce domaine, donc ça a commencé un peu comme ça. Ça faisait partie du jeu. En fait, le projet a démarré en 2018 et s’est transformé en film en 2021. Je me suis dit : « Bon, j’ai toutes ces données et je veux en faire quelque chose », mais j’avais aussi un peu peur d’un projet aussi ambitieux et de porter un fardeau aussi lourd, qui n’est pas l’histoire de mes parents, mais celle d’un pays.
Comment sont gérées les archives au Paraguay ? Sachant que le parti au pouvoir cherche à occulter l’histoire de la dictature.
Les archives au Paraguay sont complexes, car nous avons évoqué le fait que le mot « archive » est également associé à un espace de conservation. Autrement dit, si vous vous rendez aux archives nationales d’un pays, vous vous attendez à ce que tous les documents soient catalogués, à ce qu’il y ait la fiche, le procès-verbal, tout. Parler d’archives au Paraguay et d’archives audiovisuelles est un peu erroné, car cela n’existe pas. Il existe des espaces ou des personnes qui possèdent des choses, mais ils n’en sont pas les propriétaires, ils en sont les gardiens. Ils font ce qu’ils peuvent avec ce qu’ils ont. Ces gardiens, qui ont mené des recherches bien avant moi, m’ont fourni du matériel dont personne ne sait qui l’a filmé, où il se trouve, etc. Certaines choses ont été localisées, il y a des héritiers, mais ce sont des documents très anciens. Le plus intéressant et le plus fou, c’est qu’il y a 40 ans, il y avait vraiment très peu de choses. Au total, ce qu’il y a au Paraguay, c’est environ 3 à 4 heures sur près de 40 ans. Je te parle de choses officielles. Certaines personnes ont chez elles des films familiaux en 16 mm, mais pas les institutions. C’est complexe de voir les choses ainsi. Dans ce sens, je ne sais pas comment le parti au pouvoir va réagir face à ce vide presque illégal. Beaucoup de choses ont également été trouvées dans les poubelles. Il y a des choses que j’ai trouvées et d’autres que le gardien a trouvées. Certaines n’ont pas été utilisées dans le film. Par exemple, le gardien – je dis « gardien » pour ne pas citer de noms – a trouvé dans la décharge municipale une cassette complète d’une chaîne de télévision, qui avait apparemment jeté ses archives, sur la visite du pape au Paraguay. Et il y a évidemment des familles qui l’ont filmée, mais les archives officielles étaient à la poubelle. Je ne sais pas comment, mais il l’a trouvée.
Sait-on quel genre de critère ils ont utilisé pour le jeter ?
Il n’y a pas de critère. D’après ce que je sais d’autres gardiens plus petits, des gens qui ont été formés à la télévision, la décision était aussi simple que « nous avons une pièce de 4m×4m, elle est remplie de boîtes de conserve, il faut les jeter parce qu’il n’y a plus de place ». Et c’était tout, il n’y avait aucun intérêt à les conserver, aucune action systématique, juste un désintérêt total. Dans ce tourbillon d’incohérences et de décisions arbitraires, on ne peut pas parler d’« archives ». Ce sont de petits fragments de choses qui ont été trouvées.
Il est intéressant de repenser le concept d’archive. Cela me rappelle ce que disait Tatiana Fuentes, la réalisatrice de La memoria de las mariposas. En voyant son documentaire, plusieurs personnes ont dit : « Tant d’archives sur le génocide du caoutchouc ! », mais elle a confirmé qu’en réalité, il n’y en a pas tant que ça, mais qu’elles sont rassemblées dans un film, comme c’est le cas dans Bajo las banderas, el sol. Pour ce documentaire, comment avez-vous géré les ressources économiques et le matériel trouvé, notamment au niveau du montage, pour en faire un film ?
Nous avions 100 heures de matériel, entre ce que nous trouvions, ce que nous avions en mauvaise qualité, ce que nous avions comme aperçu des plus grandes entreprises, auxquelles vous écrivez pour leur dire « je veux cet archive », et elles vous répondent « bien sûr, voilà », mais avec une marque horrible, en résolution 480 pixels. Et vous avez le brut, vous avez la matière première. Vous avez donc des impossibilités de travail et une infinité de possibilités de films. Comme vous avez tellement de matériel, vous pouvez faire ce que vous voulez.
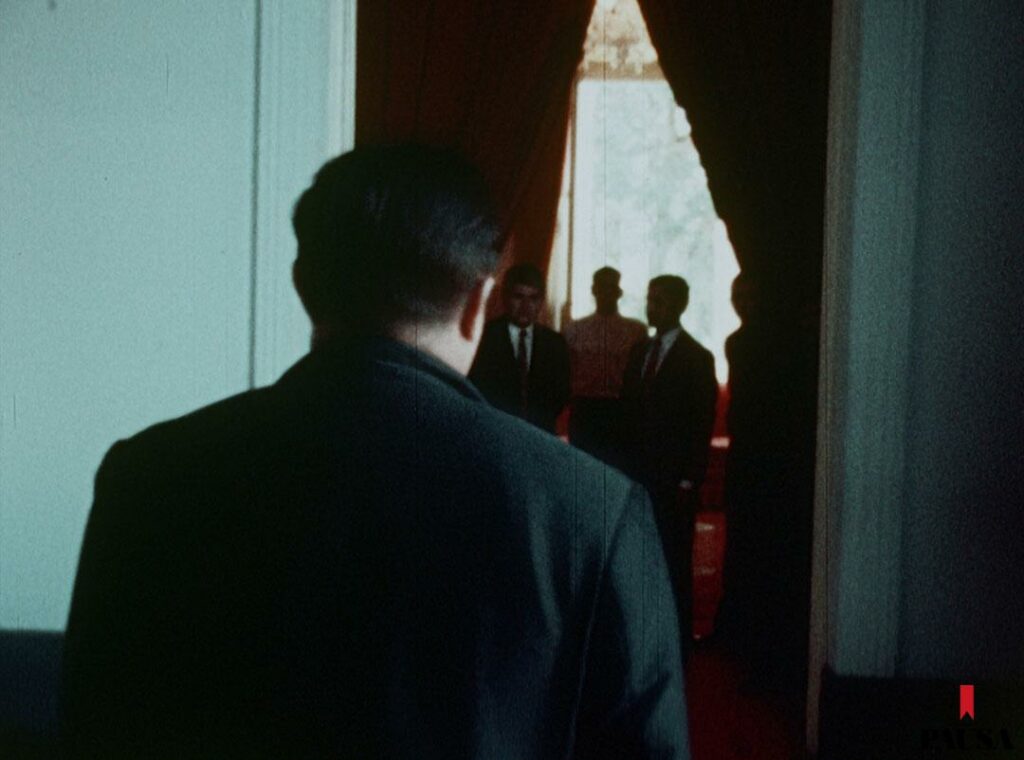
Bien sûr, dès le départ, il y a beaucoup de chemins que vous pouvez emprunter.
Beaucoup de chemins ! Ils sont infinis quand vous avez 100 heures de matériel ou plus, sur différents thèmes, qui ne sont pas des scènes que vous avez filmées. C’était un océan d’images, d’informations, de folies, que nous avons dû cataloguer pendant des années et des années, jusqu’à ce que nous trouvions la solution et que nous disions « bon, ce film sera chronologique ». D’une certaine manière, le film a toujours été à la fois dans les trois étapes : développement, production et post-production. Je le dis toujours et je pense que c’est important. Nous avons essayé d’écrire des scénarios, mais en vain. Le film s’est écrit au montage. Nous avons fait un plan, une structure, mais à partir de là… comment écrire « coupez » ? Il faut le voir. On peut dire : « Bon, j’ai la scène où Stroessner voyage à travers le monde », qui était une scène que nous avons toujours appelée ainsi et qui est dans le film. On peut la nommer, mais on ne peut pas l’écrire : il faut la monter. C’est impossible à écrire. Et une autre chose que j’ai trouvée très intéressante, c’est que l’infinité d’archives a eu une coupure. À un moment donné, nous avons estimé le coût d’une coupure et il en est ressorti, je ne sais pas, 500.000 dollars rien que pour l’achat de l’archive. Nous avons dit : « Ah, bon… ça ne va pas » (rires). Cela a également influencé la décision de chaque coupure. C’était intéressant de passer par ce processus qui consistait à réfléchir à la valeur des choses, à la valeur de mon loyer et à la valeur du film. Je me suis demandé : « Qu’est-ce que je fais ? Est-ce que je travaille pour payer ces gens [ceux qui font payer les archives] ou pour vivre ? Comment se fait-il que le loyer de mon appartement coûte dix secondes d’une archive d’un pays européen ? ». Il y avait beaucoup de questions qui nous mettaient tout le temps en échec, et elles font partie du film. Nous ne le disons pas littéralement, parce que je n’aime pas dire ce genre d’évidences. Mais le film comporte des choix esthétiques et narratifs justes, concrets. Je vais droit au but.
Oui, on le sent direct.
J’aimais que le film soit comme un coup après coup pour le spectateur. Je pense que la production s’est accompagnée de ce choix. John Berger disait que l’image a un double sens, et qu’elle est un déclencheur. Chaque plan du film est un coup de feu. Alors pour moi, ce coup de feu m’a fait penser « ok, je vais te payer 100 dollars pour ce coup de feu ; je ne vais pas payer 5000 dollars pour un parcours ». Et le film est une somme de coups de feu et de coups. Et de coups durs ! Parce que c’est une réalité dure.
On ressent cet impact en regardant le documentaire. Dans toute l’Amérique latine, y compris au Pérou, nous avons subi l’opération Condor, qui nous marque encore beaucoup. Nous ne pouvons pas dire que c’est du passé, nous vivons toutes les conséquences de sa présence, et le discours de l’époque perdure. Ce documentaire ne divague pas, il dit directement ce qui s’est passé et comment. Si, en tant que réalisatrice, je devais traiter tout ce matériel sur l’histoire de mon pays, cela m’affecterait certainement émotionnellement. Comment te sens-tu, toi qui ne regardes pas seulement un matériel pour travailler sur le plan artistique, mais quelque chose qui touche directement au cœur de notre indignation ?
Je pense qu’être entouré de ces images pendant si longtemps n’est pas sain. À un moment donné, dans mon atelier, le visage de Stroessner était partout. Je connaissais aussi les visages des autres jeunes officiers. Je les reconnaissais, je connaissais leurs noms. Et pourquoi savais-je tout cela ? Il y avait là comme une forme de questionnement : « Qu’est-ce que je fais de ma vie ? » Mais j’ai beaucoup appris, et pas seulement sur l’histoire. Car l’histoire est incroyable et pleine de nuances, mais ce n’est pas un film historique : c’est un film de sentiments et de souffrance. J’ai beaucoup appris des regards, des gestes. Je voulais m’approprier l’image. Ces enfants qui nous regardent sur les images, qui sont-ils ? Ils ont été exposés à ce discours en boucle pendant 35 ans. De toute évidence, le pays en serait là aujourd’hui si cette génération l’avait consommé pendant si longtemps. Le Paraguay est l’un des pays les plus sexistes de la région, avec l’un des taux de suicide les plus élevés. C’est aussi l’un des pays où le niveau d’éducation est le plus bas. Je ne veux pas être négatif envers mon pays d’origine ni envers l’endroit où je vis, mais je crois que seul ce genre d’exercices peut nous permettre de briser ce « quelque chose » qui nous habite. Je ne voulais pas rester « à la place des victimes » ou « des guérilleros », car je souhaitais mener une analyse plus large. Il ne s’agissait pas de désigner le méchant. Le méchant se dévoile et se décompose de lui-même.
Oui, car réaliser un film implique un processus non seulement créatif, mais aussi émotionnel.
Bien sûr ! Car, au fond, qu’est-ce que faire un film ? On peut faire un film pour gagner sa vie, pour vivre, pour exprimer ce qui se passe en soi. On peut faire un film pour divertir, pour faire rire, ou un film pour faire pleurer. On peut faire un film sur tout ce qui nous passe par la tête. Mais je crois que les bons films, ou du moins ceux qui m’intéressent, sont ceux qui résonnent en moi, mais aussi dans un contexte politique et un lieu précis. Autrement dit, d’où est-ce que je parle ? D’où viennent mes émotions ? Je ne savais pas, mais quelque chose me préoccupait, alors j’ai écouté, pour voir ce qui se passerait. J’ai laissé cette sensation mûrir un moment. Par ailleurs, je travaillais dans une agence de publicité…
Donc, dans un domaine complètement différent…
Oui, je travaillais pour gagner ma vie, comme tout Latino-Américain. Qui gagne sa vie comme réalisateur ici ? Je travaillais dans une entreprise pour vivre, payer mon loyer, et en même temps, je réalisais le film. Comprendre comment se font les films latino-américains, trouver le bon moment pour s’y connecter, a été tout un processus pour moi. Mais il y avait quelque chose en moi et dans le film qui m’a saisi. Il me disait : « Oui, c’est ça, je vais y aller et je vais faire naître ce son en moi.»

Vous avez probablement déjà entendu parler de la loi anti-cinéma au Pérou, qui donne à l’État le contrôle et le pouvoir de désapprouver et de discriminer différents thèmes et films produits dans le pays. Au Paraguay, votre cinéma bénéficie-t-il d’une quelconque protection ? Ou est-il lui aussi en situation de vulnérabilité ou sans protection ?
La création de l’Institut audiovisuel est assez récente. Il a sept ans. Notre projet a été approuvé par l’Institut du film. Il bénéficie de leur soutien. Ils comprennent de quoi je parle. Nous ne subissons aucune décision gouvernementale quant à ce qui est dit ou non. Dans d’autres domaines, comme celui des espaces culturels, nous subissons actuellement une persécution politique des espaces qui ne correspondent pas aux intérêts commerciaux actuels. Cela n’a rien à voir avec le cinéma, mais cela concerne le monde culturel, qui y est d’une certaine manière lié. Aujourd’hui, nous ne subissons pas le même niveau d’intervention qu’ici au niveau du cinéma, mais nous en subissons au niveau culturel. Les espaces culturels, les espaces de résistance, les espaces où s’expriment les voix dissidentes face au gouvernement actuel, sont aujourd’hui persécutés, condamnés et emprisonnés.
Pensez-vous que vous, ou le film, pourriez subir des répercussions négatives ?
Il y a eu des cas dans d’autres domaines artistiques qui ont eu des répercussions négatives, mais comme je n’ai pas d’exemple similaire dans le cinéma, je ne sais pas ce qui pourrait arriver. Des films ont été réalisés contre d’autres présidents, principalement liés au trafic de drogue et à des choses de ce genre, et rien de majeur ne s’est produit. On verra, mais je ne pense pas qu’il se passera quoi que ce soit. Vivons-nous en démocratie ? Du moins, j’aimerais le croire.
Nous essayons toujours de faire en sorte que ce soit le cas, ne serait-ce que par nos actions, à défaut d’influencer les décisions des autorités. Ce film ouvre la voie à une démocratie vécue pleinement, car il nous permet d’aborder l’oppression, la dictature, le fascisme, et de souligner à quel point il est choquant de voir un nazi du Troisième Reich vivre au Paraguay.
En effet, ils lui ont donné un passeport paraguayen. Nous le montrons dans le film. J’ai du mal à parler du Paraguay, ce pays où je vis, où je suis né, mais c’est un refuge idéal. Un endroit où l’on est introuvable. Le Paraguay n’a pas encore Google Street View ! On y croise toujours des personnages étranges, et on se demande : « Que fait ce Suédois au Paraguay ? » Il y a de nombreux cas comme celui de Mengele. D’ailleurs, la sœur de Nietzsche a créé la première communauté antisémite d’Allemands hors d’Allemagne, au Paraguay, au début du XXe siècle. C’est un point de transit, un fief mafieux, une plaque tournante du trafic, situé entre les deux plus grands pays de la région, l’Argentine et le Brésil. C’est un lieu conflictuel, en ce sens. Situé au cœur de l’Amérique latine, pris en étau entre les deux superpuissances, et enclavé, contrairement à l’Uruguay. L’affaire Mengele n’est qu’un exemple, mais nous savons tous que des choses se passent au Paraguay. Il existe une importante communauté nazie au Paraguay. Je pense que ce qui surprendra le moins les Paraguayens [en voyant le documentaire], c’est l’histoire de Mengele. Le Paraguay est un endroit où l’on peut se cacher et où personne ne peut vous trouver.
Et comment faites-vous pour garder la foi ?
Grâce à la communauté d’amis, la communauté d’artistes, la communauté de créateurs et de penseurs, qui est très vaste et exerce une forte attraction. Je pense que l’oppression est importante, mais les penseurs sont très brillants, et nous formons un groupe ; je ne suis pas le seul à faire cela. Il y a des gens qui font ça depuis longtemps dans d’autres domaines, parfois même plus engagés politiquement que moi, au théâtre, en littérature, dans les arts visuels et en danse. Au Paraguay, de nombreuses expressions artistiques s’épanouissent, portées par des personnes plus jeunes ou un peu plus âgées que moi, et c’est ce qui nous donne espoir. Nous croyons au changement. Je crois au changement.
Allez-vous poursuivre vos projets de films et d’archives, ou avez-vous une préférence entre les deux ?
Honnêtement, je souhaite prendre un peu de distance avec la dictature. Je veux explorer d’autres pistes, mais j’ai aussi beaucoup de matière que je veux continuer à travailler. Je crois avoir trouvé dans le film quelque chose de très personnel, quelque chose que je ressens profondément. J’y ai trouvé une esthétique, quelque chose que je recherchais, et je vais continuer à l’explorer. Non pas en la remaniant, mais en essayant de l’enrichir. J’aime beaucoup le travail d’archives. Je n’aime pas tourner, alors je ne sais pas, peut-être qu’un jour je ferai un film de fiction, mais je n’ai pas beaucoup d’expérience dans ce domaine ; je n’ai jamais travaillé avec des acteurs.
De plus, la fiction a un début et une fin, alors qu’un documentaire est infini.
Il est infini, c’est un film sans fin ! J’aime explorer le cinéma. Je dirige également un festival de cinéma au Paraguay, l’ASUFICC. Cette année marque sa cinquième édition. Je fais partie de l’équipe de programmation et je suis cofondateur du festival. Nous nous efforçons toujours de donner de la visibilité aux projets paraguayens et latino-américains au Paraguay. Nous grandissons. Nous sommes petits, mais nous avons de grandes ambitions.
Par Mariale Bernedo / cinencuentreo / Traduit par Kinolatino

